par Françoise de Laroque
Miroir noir1
Alors que, d’ordinaire, la fiction romanesque produit l’illusion du réel, Le roman d’Adam et Ève, fondé sur le constat que nous n’avons en guise de réel que des images, démonte les illusions. Narrateur (le je du récit) et personnages cultivent, chacun selon son mode d’expression – langue, théâtre, photographie, politique – les images sans perdre de vue que ce que nous nommons réalité reste inaccessible. Le réel bien sûr dans le roman comme dans la vie fascine, affleure, cogne – sans gravité lorsqu’une bousculade dans le métro sort le narrateur de ses cogitations ou violemment quand l’horreur des purges staliniennes réduit Igor à l’incapacité de former des images : « Je ne vois rien. Je ne vois qu’un sol de béton gris et froid. Une étendue insignifiante et cependant terrible. » Notre fonction représentative connaît en effet fulgurances, pannes et dérives. Faillible parce qu’elle éloigne du support originel ; elle peut aussi prouver son extrême efficacité en s’en passant et en tirant sa force de l’éloignement. L’impensable peut alors devenir réalité : ainsi la culpabilité de l’innocent, lorsque l’accusé forge lui-même l’évidence de sa trahison. L’inexistence devenir révélation : ainsi Dieu. « Si l’on considère tout ce que son inexistence a produit dans l’histoire des existants, il faut bien reconnaitre qu’aucun de ces derniers n’a jamais pu en faire autant, même les plus puissants. » L’existence est périssable alors qu’images et pensées entrent dans l’intemporel. Certaines s’évanouissent, d’autres ont la vie dure. Au lieu d’être à jamais perdu, le Paradis hante encore les consciences. Le roman d’Adam et Ève est une double enquête culturelle et concrète (sans participation policière mais avec parfois des allures d’espionnage) dont le fil conducteur est le Paradis. Sur la piste de son ami disparu, le narrateur traverse les répétitions d’une pièce de Boulgakov, la lecture de la Genèse, parcourt des livres rares, s’intéresse aux pratiques des Adamites, interroge des gens de rencontre sur la façon dont ils imaginent Adam et Ève – leur représentation est un miroir qui reflète leur image ; le narrateur peut dresser leur portrait – reçoit confidences et informations d’émigrés russes, découvre avec stupeur qu’un Paradis soviétique avait été planifié sous Staline et qu’en cette fin du vingtième siècle un Paradis orthodoxe, sorte de parc d’attraction est en voie d’aménagement. L’ami disparu, photographe, engagé dans un mystérieux reportage dont personne dans son entourage ne connait le but, la destination, ni le commanditaire, serait-il le photographe du Paradis ? Des vestiges du premier, des travaux du second ? Les photographies envoyées au début du voyage – une Ève, un serpent, une substance aérienne, quelque chose comme de l’espace pur – seuls indices, conduisent la recherche dans ce sens.
Au cours de son enquête dans et hors les livres, le narrateur rencontre des hommes de foi et des hommes d’intérêt. Les hommes de foi au sens large sont ceux, mystiques, alchimistes, photographes… qui pour traverser le miroir, toucher à l’essence des choses, dans rituels, chambres d’amour ou chambres noires, distillent et subliment ce qu’ils ont prélevé du réel. Jean, avant sa disparition parlait d’un reportage originel, de photographier ce que nul n’a encore vu.
Les hommes d’intérêt façonnent ou exploitent les mentalités collectives pour assurer leur domination. Ils font miroiter des paradis spirituels, idéologiques, économiques pour susciter l’adhésion du plus grand nombre. Stolypine espère des progrès technologiques qu’ils lui livrent une machine dont la puissance attractive dépasserait celle de la religion. Il croit l’avoir trouvée dans ce nouveau virtuel qui se manifeste dans le réel et place l’homme non plus devant mais dans l’image. Cette fois l’illusion est complète. Dans cet artifice inclusif et programmé, il est aisé de susciter le désir, le satisfaire, le renouveler et ainsi de suite. Il suffit de trouver le bon rythme pour animer un présent permanent.
Le narrateur, homme ni d’intérêt, ni de foi, mais du verbe condamne cette fin du dédoublement de l’image qui tenait l’homme face à elle, lui offrant un miroir pour qu’il y lise sa pensée. Dans cette fusion du réel et de l’imaginaire, de l’autre et de soi, du dehors et du dedans, il voit une version-pacotille de l’absolu, un absolu du non-sens puisque au lieu d’un au-delà, de l’essence des choses, de l’origine, le virtuel ne reflète ou plutôt ne consomme que ses propres images. Un enfer.
Le narrateur est invité à visiter le paradis de Stolypine qui semble bien le serpent du roman. Une lettre glissée avec le billet d’avion sous le paillasson du supposé voyageur lui décrit minute après minute la visite qu’il n’a donc plus besoin d’entreprendre. Il y découvrirait la splendeur de l’arbre interdit et, au moment où surgit le serpent, la solution de l’énigme : le foudroiement par le Sans-Image de son ami, photographe du fruit défendu. Le roman se termine sur ce récit. Échec du narrateur qui a perdu la parole, usurpée définitivement par Stolypine ? Ou, à l’inverse, victoire d’un très ancien virtuel, celui de l’écriture ?
Le roman dessine un futur inquiétant. Mais la prose lumineuse de Bernard Noël invite à la pensée et non à la peur.
184 p., 23,00 €
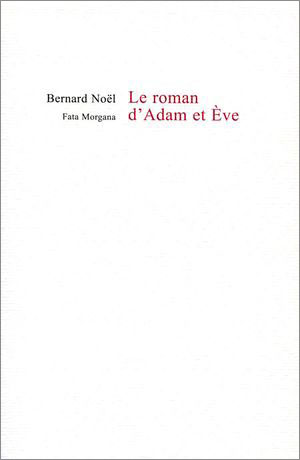
1. Un miroir noir est un miroir dont le polissage est conçu de telle sorte que sa surface ne reflète rien.





