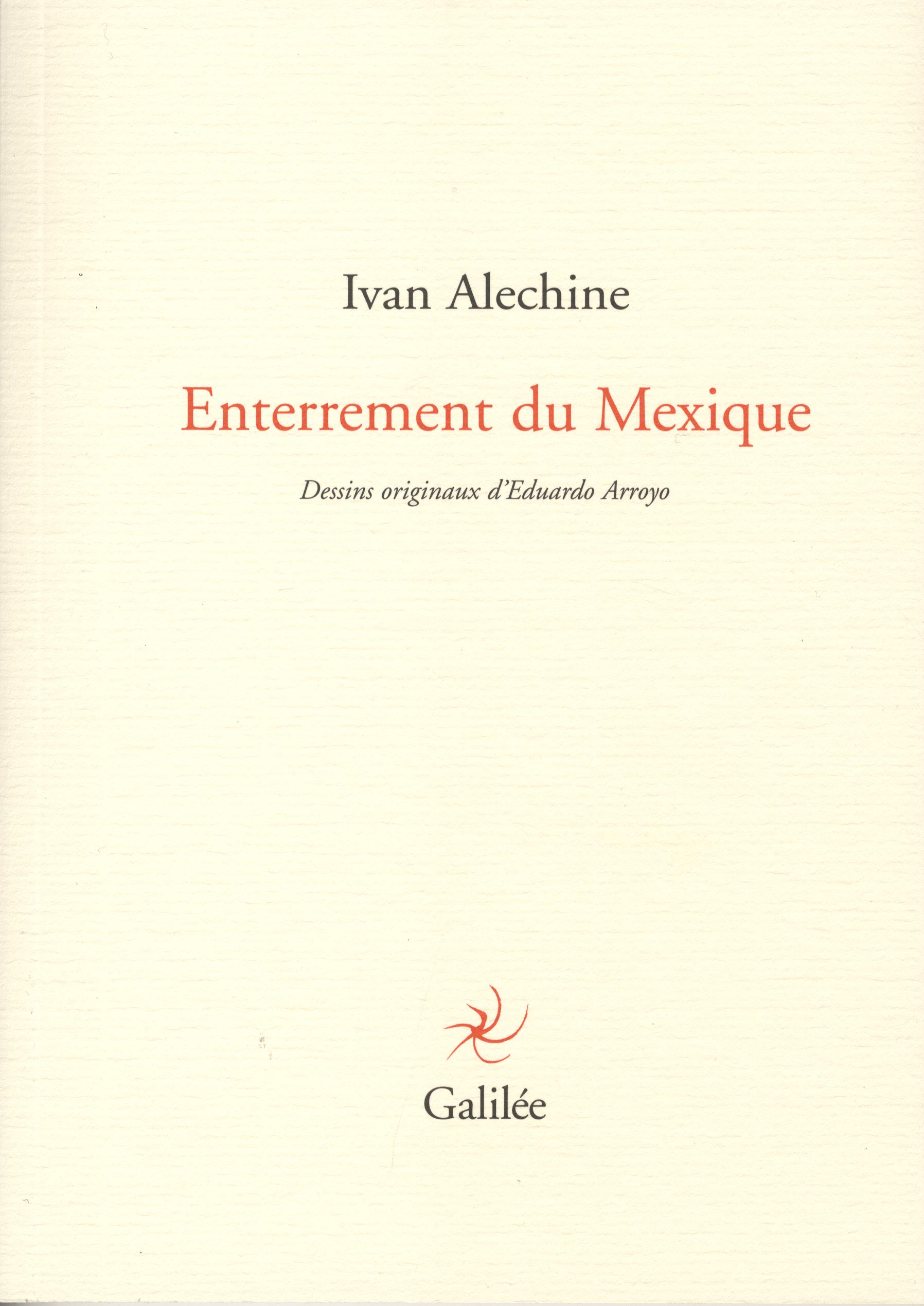par Tristan Hordé
En exergue, Ivan Alechine cite un fragment du franciscain Bernardino de Sahagun sur un mythe des Indiens d’avant la conquête espagnole, et c’est ce Mexique détruit qui hante le livre. Le poète rencontre une immense pauvreté, matérielle et morale, celle des femmes qui vendent des bonbons et des cigarettes pour survivre, celle des villages qui ont abandonné leurs traditions, celle des villes où domine par la télévision « l’esprit de la pornographie (les actualités, les comics, les jeux, les entretiens, les séries qui ne disent rien) ». La recherche continue du profit a abouti à la déforestation, à la destruction partout de la nature, à la violence des relations humaines et, comme partout, à l’uniformisation des pratiques sociales : par exemple, les mêmes sports avec « vêtements en loques made in India / lancer de balle made in China filets made in Indonesia / » etc. Comme partout encore chacun connaît « la solitude l’isolement ».
Restent pour I. A. la marche, pour regarder comment les uns et les autres vivent, et la sexualité (« jouir / plaisir de savoir que l’autre a joui »). Mais aussi le souvenir de tous ceux qui ont vécu et créé au Mexique avant que le pays devienne un lieu sans esprit et « dire que, ici, (…) c’est très joycien que je suis en exil comme James Joyce à Trieste réécrit Dublin, d’exil en exil ». Il se rend à l’endroit où Jack Kerouac écrivait Docteur Sax, évoque Burroughs qui vivait dans le même immeuble avant William Carver, puis Ginsberg, Orlowsky, Corso, « les ombres d’Orson Welles de Sergueï Eisenstein / de Luis Bunuel et de Juan Rulfo », de Malcolm Lowry…
Ce livre d’un « exilé dans le temps », souvent mélancolique, est aussi une fresque vivante d’un pays qui a violemment « enterré » son passé sacrifié à l’économie de marché. Prose et poésie mêlées répondent bien au projet d’écrire « sur le motif » ; « je recrache les fleurs que j’ai vues », note I. A., et c’est pourquoi « [sa] poésie est ici politique » et non pas moralisante.