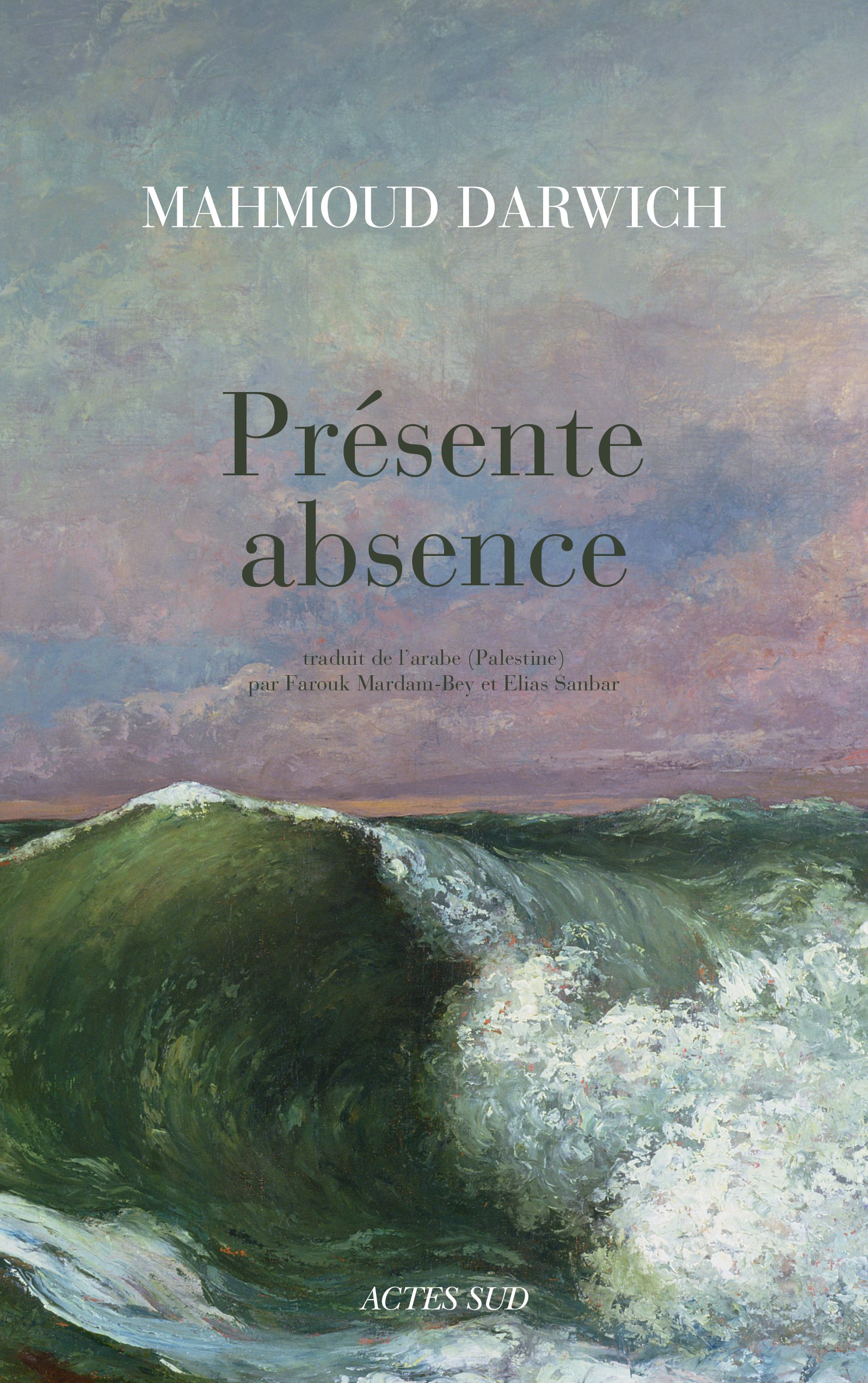par Christian Travaux
À l’instar de Sarraute, dans Enfance, ou d’Apollinaire, dans « Zone », dans Présente Absence Mahmoud Darwich parle de lui en se tutoyant, et se dit en se désignant comme un autre. Un double « je ». D’un côté, le « je » véridique, qui il est et qui il fut. Et, de l’autre, le « je » lyrique, le « je » littéraire et écrit, le « je » des mots, qui est un « tu ». Un miroir. Un visage absent, où l’on peut se voir et se dire, et s’écrire, et se contempler, dans toute son étrangeté. Lui, l’étranger réfugié, le palestinien, né sur une terre, désormais, israélienne, dépossédé de son histoire, de son passé, et de son identité – et, perpétuellement, en errance.
Mahmoud Darwich. Une vie qui ne fut la sienne que par la contrainte et l’histoire, l’occupation et les chars, et l’écriture. Et devenu, littérairement, la conscience de son pays, la Palestine. En 2006, il publie un de ses tout derniers livres : Présente Absence. Il s’y interroge sur lui, sur sa vie et sur son parcours, et tente d’éclairer son passé à la lumière de son présent, du peu d’avenir qui lui reste, et inversement. Il mourra en 2008, à Houston, au Texas, et se sait déjà condamné à très court terme.
Aussi, en 20 chapitres d’une prose dense et intense, fait-il un retour sur sa vie. De ses débuts, sur une terre alors palestinienne, Saint-Jean d’Acre et Haïfa, où il se souvient de ses frères, les oiseaux, l’aube se faufilant par les trous de sa porte en bois, ou de ses parents, occupés à hacher les feuilles de tabac. Toute une enfance, où la terre pouvait voler, où les arbres étaient faits d’une âme pour demeurer et s’isoler. Et où l’école était un lieu où s’apprend la maîtrise des mots : qu’un mot bien dit, bien prononcé, fait naître au jour, sur la page, l’objet nommé ; que les mots sont choses et maison, si on les assemble tous ensemble. Qu’ils possèdent l’air de la mer, sa danse et son rythme ancien, appellent l’obscur. Et que les apprivoiser permet d’apprivoiser le monde. Ainsi, est-ce le mot réfugié qu’il interroge et qui le blesse, quand ici devient un là-bas, pour lui, lointaine sa maison du passé, et le passé même, soudain, lui-même nouveau-né, dans un autre pays tout neuf, qui n’est plus le sien désormais. Ainsi, l’exil.
Bien des pages sont consacrées à l’exil qui fit de Darwich ce qu’il fut, ce qu’il a été. Passager, toujours passager entre un ici et un ailleurs, habitant les aéroports, seul lieu possible de l’exilé, pour qui n’a pas même de pays. Ou la prison, quand – opposant au régime israélien – il y séjourne plusieurs fois, et se trouve désormais privé de lumière et de liberté. Mais non pas de poésie. Car la poésie est au cœur de la vie de Mahmoud Darwich. La poésie, comme une promesse de liberté, un inconnu fulgurant, sa seule, vraie, patrie. Les mots, pour lui, en poésie, sont absence qui devient présence, ou une présence qui s’absente, sont inquiétude existentielle, terre qui porte, pensée qui guide, et sont vie, sont vie, comme l’amour, comme la haine, et comme la douleur. Et comme la mort.
Et Mahmoud Darwich de dire – outre l’exil et l’exode, et l’errance, et sa patrie – tout le quotidien de sa vie : les femmes aimées, bien sûr, ou sa part féminine ; les frissons qui l’ont fait trembler ; les corps où se faire sa demeure, et exister. Mais aussi son emploi du temps : une journée, une de ses journées, l’installation face à la page, l’écriture et la poésie. Ses sommeils ; son évanouissement, quand il fit un arrêt cardiaque ; l’électrochoc, le corps branché à des tuyaux, halluciné par les doses d’anesthésiques. Et puis, le retour au pays, les adieux à Tunis, le fait de pouvoir retrouver sa terre, les arbres et les mots de sa terre. Gaza. Ramallah. Jéricho. Haïfa. Là où il est né, la Galilée. Sa mère. Et la tombe de son père.
Mais les lieux ne sont plus les mêmes. Les villages qui sont restés rappellent les villages enterrés, disparus, l’herbe, le passé. L’État s’est bridé d’interdits. Les réfugiés, mis dans des camps, ne peuvent pas rivaliser avec les palais de leurs geôliers. Et le regard même a changé. Désormais, revenir ici, c’est voir, sur la tombe de son père, sa propre tombe à venir. C’est voir le passé au présent, et s’il lui est encore possible d’écrire, quand écrire, c’est dire non, c’est refuser la servitude, et c’est lutter. Qu’est-ce qu’un poète palestinien, s’il n’est plus palestinien ?, s’écrie-t-il, plus en exil, plus en errance, plus dans l’exode, et que sa terre l’accueille alors ?
Je suis venu, mais je ne suis pas arrivé
Je suis là, mais je ne suis pas revenu,
écrit Darwich. Pourtant,
Me voici, le voici
voici l’enfant turbulent, fils d’un turbulent,
d’une turbulente, fils de ton eau et de ton feu.
Fils de sa terre, où il aurait voulu mourir, Mahmoud Darwich livre, ici, un bilan poignant de sa vie et de sa pensée. Dans une langue d’une rare beauté, d’une incandescence maîtrisée, d’un feu souverain, il nous laisse comme testament – sans nul doute, son dernier livre traduit en français – ces fragments d’une vie brisée, renouvelée par la force de l’écriture. Et par la croyance qu’aux guerres fanatiques, aux extrémismes, seule la poésie peut ouvrir les yeux sur le fait d’être un homme. Juste un homme, parmi les hommes.
Actes Sud
« Sindbad / Mondes arabes »
160 p., 17,00 €