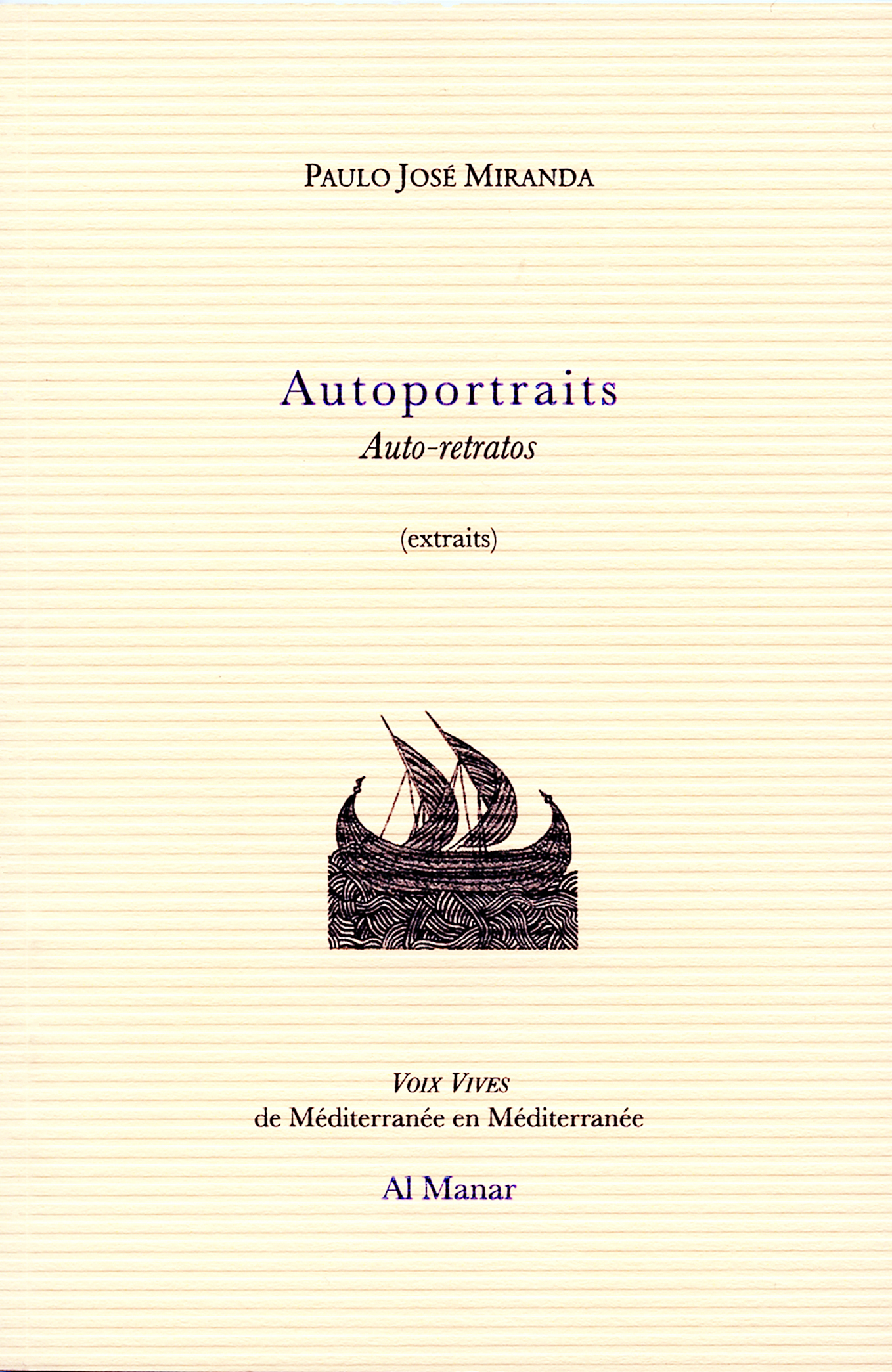par Christian Travaux
Se dire. Toujours se dire. Puisqu’écrire, ce n’est que cela. Montrer visage. Étaler ses veines sur la table. Poser son foie, ses os, ses organes, son intérieur. Puisqu’il n’est possible jamais d’y échapper, ou d’échapper à soi-même. Puisque, toujours, dans la syntaxe et dans les mots, dans la trace d’une syllabe, le geste scriptural simplement, nous nous disons. Toujours nous nous disons. Et nous laissons portrait de nous.
Autoportraits est donc un livre sur l’écrire, sur l’écriture. En un choix de 28 portraits, le plus souvent en une page, plus ou moins, Paulo José Miranda ose s’écrire, ose se décrire continûment, sans afféteries. Juste soi, devant, face à soi. Et ce n’est pas une mince tâche. Car, quoi dire pour ne pas dire ce qui vient s’exhiber d’abord, se montrer pour cacher le reste ? Quoi montrer, pour ne pas montrer qui on ne veut pas que l’on voie ? Quoi écrire pour se décrire ? La vie n’est pas de mots, n’est pas faite de langue et de voix. Et l’être n’est pas de syllabes. Aussi tourne-t-on après soi, doit-on toujours recommencer, 28 fois dans un choix d’extraits, afin de saisir ce qui est, ce qui vient, ce qui accompagne, et qui fait de nous comme notre ombre, un visage, une identité.
Pourtant, ce disant, Miranda dit aussi, bien évidemment, la vie qui est, la vie qui va. Un ensemble de notations du quotidien qui rend sensibles ces courts textes, ces vers jetés : les fruits pourrissant sur la table ; le soleil, un banc du jardin ; les pigeons roucoulant au loin ; et le cathéter qui se rompt ; l’infirmière vient. Toutes choses qui nous arrivent, et nous font soi, font notre vie – comme cette feuille qu’on voit tomber et à quoi on s’identifie. L’on traîne son ombre, comme soi, comme figure de soi. Et on ne cesse de l’interroger. Qui donc es-tu ? Qui suis-je donc ? Le poème parle, et se tutoie, et s’interpelle, pour comprendre quelque chose à l’être. Et au fait d’être.
Car, enfin, il y a la mort. Paulo José Miranda ne pense la vie, l’existence, qu’à partir de ce terme instable, de cette fin. Tout s’éclaire par cette borne. Tout prend raison par ce mur blanc. Notre tête sortant du ventre de notre mère. Notre chemin, qui soulève des monceaux de terre pour nous recouvrir peu à peu. C’est de cela, et de cela seulement, qu’il dit bâtir son existence. Une odeur de cadavre imprègne nos vêtements. Et nous tombons, continûment, dans cette vie, dans la mort, en semant des fosses, des trous d’oubli, sur notre route. Aussi faut-il (comme il fait) conserver, conserver toujours, comme l’on peut, et bien faiblement, maladroitement, là ce qui naît sous nos yeux, chaque jour, toujours. Aussi faut-il noter cela, ce qui vient et le protéger, afin que la tombe qui s’ouvre devant nous, toujours un peu plus, ne l’emporte pas tout à fait.
Et que l’on meure, acceptant de devoir mourir, et s’apaisant.
Traduit du portugais par Sofia Queiros
Al Manar
« Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée »
64 p., 12,00 €