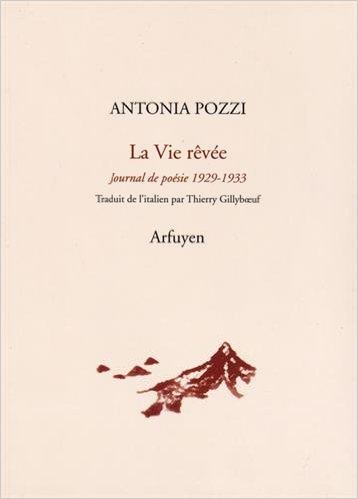par Christian Travaux
Il est des œuvres, à la lecture, incendiaires, incandescentes, qui réveillent des peurs enfouies, brisent des portes, font revivre des êtres morts. Ainsi, Pozzi. Une vie brève. Antonia Pozzi. 26 ans. Une fin tragique. Retrouvée morte, suicidée, dans les environs de Milan, en plein décembre. Peu d’années. Mais une œuvre dense, intense, irradiante et solaire, comme une lune vue en plein jour, un orage sec d’été, une mer d’herbes. Faite de textes au jour le jour écrits, tous datés et situés. Un journal tenu dix ans, ouvert en 1929 (l’auteur a alors 17 ans) et refermé avec la mort, dont seules quatre années sont ici (1929-1933) traduites et présentées.
Des vers calmes, sereins, d’abord. Des vers comptés, mesurés. Une tendresse pour le paysage et les choses de l’existence. Mais, très vite, une voix ténue, fragile, vient paraître et parler d’un amour impossible à dire, à vivre, d’un tourment, d’une peine, d’une absence qui ronge et troue le corps, fait se tendre la voix pour happer, essayer de dire, ou pour combler le manque immense de celui qu’elle aime, et qui fuit. Et de l’enfant imaginaire qu’elle voulait, qui aurait pu naître de cette relation inavouée. « Il mio bambino finto », écrit-elle. Mon petit bébé pas encore né, dit-elle encore, mon enfant pour de faux, dont elle imagine la paume de la main, le petit visage sans traits, le visage incréé, et le berceau enseveli.
Une douleur qui la poursuit, au point de faire que se dépouille son langage jusqu’à l’extrême. Peu de vers. Des formes courtes. De plus en plus, un vers qui prend son envol vers les hauteurs, en abandonnant la métrique traditionnelle, en s’allégeant de toute ponctuation, sinon le piolet du tiret. Et des strophes irrégulières, ramassées, prêtes à s’élancer, à s’élever, à s’écrouler, rebondir, et recommencer, dans une tension permanente. Des images. Que des images. Une parole faite image, où chaque mot est un feu de braises, un incendie, une lumière fugitive, un bruit d’étincelle. Ainsi Pozzi voit-elle sa vie comme un lac, comme une cascade, comme une alouette son cœur, et son corps, pauvre, maigre chose, comme une gerbe de joncs qui tremble auprès de l’eau qui coule, primevère dans la prairie bleutée du ciel, deux hirondelles qui se croisent, avec son amour.
Son amour mort. Lampe éteinte. Coquillage vide. Fruit vidé de sa graine pure : toutes sont images d’ascension, ici, de chute, d’élévation et d’abattement, désir d’ascèse et d’abandon, d’épuisement et de renoncement. Très souvent, c’est à ses montagnes, ses « mamans-montagnes », comme elle dit, qu’elle s’adresse, leur demandant de la délivrer de sa peine, de son être, de sa douleur. De l’alléger, la soulager. Et de faire – comme Hölderlin – qu’elle puisse aller vers plus de jour, vers plus d’air, vers plus de lumière. Mais, inversement, c’est aussi à la terre qu’elle demande aide, refuge et soutien. C’est aussi dans la terre qu’elle veut s’enfouir, s’ensevelir et disparaître comme pour ne plus jamais souffrir, ne plus jamais sentir le mal qui la ronge, cet amour né pour personne, donné pour rien, et dont nul ne veut – sinon elle.
Sinon elle, dans une autre vie. Une vie rêvée, imaginée, parallèle à la sienne – celle qu’on vit tous les jours, dont on suit le cours, et que l’on ignore toujours. Une vie. Une vie à deux, où l’on se sentirait aimée, désirée, et accompagnée. Que l’on vivrait, jour après jour, dans une eau douce, et calme, et tiède. Où l’on aurait eu un enfant. Un enfant. Une chose morte. Ou une chose souhaitée, tant qu’on finirait par passer de l’autre côté du miroir de la vie, de notre existence, pour lui demander de répondre et d’exister :
Et quand il sera né
tu ouvriras la fenêtre
pour que nous puissions voir
toute l’aube –
toute l’aube fleurir
dans notre ciel –
Et il dormira –
tout petiot –
dans son blanc berceau
et la lumière tombera
sur lui
mouillée
dans ses yeux
par mes larmes.
2 février 1933
Ainsi, Pozzi, dans ce Journal de Poésie, inoubliable.
Traduit de l’italien par Thierry Gillyboeuf
Arfuyen
« Neige »
320 p., 20,00 €