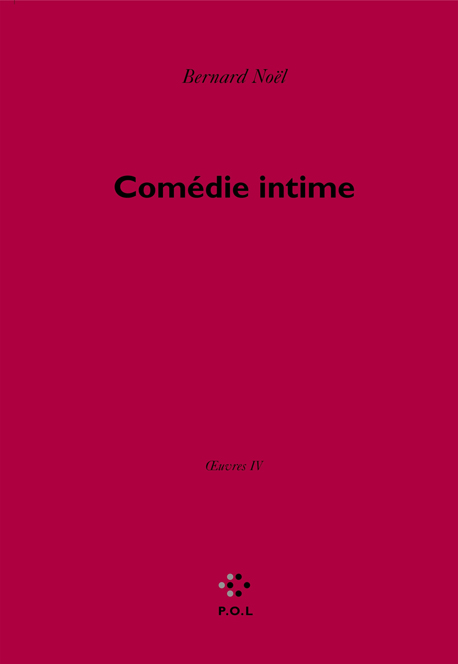par Jean-Luc Bayard
Un livre parfois énonce une limite, de l’autre côté de laquelle il provoque ce qui vient. Ce faisant, il décide de la suite. Ainsi Le Syndrome de Gramsci (1994), qui, sur l’incident banal d’un trou de mémoire, de la perte d’un nom « depuis toujours fraternel », choisit, plutôt que de résoudre, d’amplifier, de creuser une voie qui engage l’écriture. Alors le roman devient performatif, il fait ce qu’il dit, et radicalise à l’échelle de la langue, à l’horizon de l’œuvre, ce qui n’était que la crise d’un récit : le nom est désormais perdu, et celui qui écrit ne dispose plus que des pronoms pour tenir tête aux phrases, et s’avancer avec elles comme un nageur à la surface.
Ainsi s’approchent ces curieux récits, que leur auteur appelle « monologues », et qui sont, tour à tour, monologues du vous (La Maladie de la chair, 1995) ; du je (La langue d’Anna, 1998) ; du il (La Maladie du sens, 2001) ; du elle (La Maladie de l’espèce) ; du tu (Le Mal de l’intime), – et du nous enfin (Monologue du nous, 2015), qui achève une traversée de vingt ans et suscite le recueil de l’ensemble.
Qu’importe que l’on reconnaisse, dans l’ombre, le personnage qui aimante l’écriture de tel ou tel récit (Georges Bataille, Gérard de Nerval, Stéphane Mallarmé, Anna Magnani…) : on devine l’affirmation d’une communauté obscure, qui s’efface, mais c’est l’époque, la nôtre, qui les oublie, perdant tous ses repères : l’amnésie initiale se révèle plus grave, elle est celle d’un aujourd’hui où se dissout le temps.
De l’espèce et de l’intime, de la chair et du sens : cela fait beaucoup de maladies, qui découlent peu ou prou du même syndrome. L’auteur s’en explique depuis le monologue qui excite l’intime : « Tu ne sais plus rien. Tu franchis sans la voir la ligne qui sépare ce jour du jour suivant alors que tu as souvent espéré un baptême des ténèbres en franchissant cet équateur. Tu l’as peut-être reçu de quelque veilleur dissimulé dans les plis du temps, et ne serait-ce pas l’origine de ta maladie ? Tu dis à qui veut bien t’entendre que cette maladie a permis que tu te sentes mieux portant. » Le Syndrome se souvient de ce voile opaque : « Une noirceur m’a pris, une sorte de lumière noire. J’avance parfois ma main dans cette direction », il l’avance ici pour réunir La Comédie intime, que le spectacle soit complet.
Aux six monologues s’agglomèrent ainsi « Les têtes d’iljetu » : ce titre énonce une belle triangulation qui convoque aussitôt Les premiers mots, au motif que ce livre avait été le premier à l’expérimenter, vingt ans avant le Syndrome, et voici que l’espace de La Comédie excède maintenant quarante années…
Les textes n’en finissent pas, s’écartant, de se fondre. Les premiers mots et « iljetu » se trouvent soudain face à face, à l’angle d’un autre rapprochement. Le souvenir vient d’« iljetu », de deux soldats assis sur le Chemin des Dames : « Je me suis approché et j’ai vu qu’ils n’avaient plus au sommet du corps qu’une boule rouge ». Si tu t’approches lentement, reprends les textes dans l’ordre, si tu repars des Premiers mots que lis-tu ? Ceci : « Tu as un trou dans ta tête. » Alors les mots accourent par-dessus les mots, comme un visage sur un autre visage, et tu cours aussi, lisant, comme celui qui a vu le trou de mémoire, et les mots s’enfuient depuis le nom perdu, et peut-être sais-tu, maintenant, que tous ces livres s’écrivent depuis cet abîme, qu’ils poursuivent le sans-nom sous le masque du sans-visage, pour reconnaître les mots comme le nom de l’autre… Et sous le nom ce n’est pas le je, non, c’est Le-on.