par Christian Travaux
Laudato sie mi’ Signore cum tucte le tue creature
spetialmente messor lo frate sole
lo quale’è iorno, et allumini noi per lui (...)
Laudato si’ mi’ Signore per sora luna e le stelle (...)
per sora nostra morta corporale1 (...)
Ainsi devrait-on commencer chaque ouvrage de poésie, chaque journée. Être témoin de cet univers à son aube. Se faire accueil. Une prairie, un fleuve, une fleur, un arbre, un soir : tout un monde est là, devant nous, comme la chair d’un fruit à goûter, à savourer. Chaque chose en son temps, son lieu. Et toutes les choses en leur branle, leur durée, leur écoulement. Les recueillir. Les surprendre. Les conserver, dans leur fugacité tremblante, leur appel, leur instant à peine effacé sitôt qu’aperçu, perdu. Les accepter. Et bénir, constamment bénir, tout ce qui est là devant nous, car c’est bien là juste pour nous ce miracle que cela soit, comme ce bref passage sur la terre, en offrande, en présent, en prix de cette vie.
La vraie gloire est ici, dit François Cheng, dans cet ouvrage divisé en trois sections : Par ici nous passons ; Lumières de nuit ; Passion. Il y tente, en mots légers, frôlés à peine, prononcés comme à demi mot, en poèmes souvent fort courts, d’exprimer la présence au monde que nous avons, où nous vivons, la splendeur de chaque chose. Et non pas seulement la présence ou la splendeur de chaque chose, mais ce vide qui les relie. Ce vide plein, médian, par quoi l’on rejoint la vraie Voie. La juste voix. Cet entre-deux de la matière qui fait se rejoindre le haut et le bas, le grand, le petit, la fin et le commencement, comme le proche et le lointain. Fait se conjoindre les contraires d’un même monde, un même espace, pour que l’opposition – pour nous, évidente, comme allant de soi – des choses entre elles et des êtres, disparaisse, s’efface et tombe.
Pour Cheng, la source et la mer, par la pluie et par les nuages, ne sont jamais que retrouvailles. Les feuillages ont des échanges avec les nuages. Les fruits sont étoiles dans leur milieu, dans leur cœur sont microcosmes. Le germe et le terme sont proches. Tout ce qui est perdu revient, est repris lors de cette vie qui est constante circulation. Et la poésie n’est bien là que pour justifier cet ensemble qui rassemble les opposés, les fait se joindre. Pour justifier et pour comprendre ce qui fait que tout, êtres et choses, invisible et visible ensemble, existent sur la même terre, se partagent le même lieu, et sont habitants d’un même monde.
Et c’est pourquoi il faut entendre François Cheng dire sa poésie. Il ne lit pas. Il projette contre le mur du silence un son qui explose, vient buter, juter, s’épanouir, et résonner. Il fait rebondir le silence, s’exprimer – comme au sens premier, faire sortir un jus ou un suc – la parole, les mots qu’il dit. Et dans chaque syllabe prononcée, chaque son, chaque lettre même, trouve à se dire une existence qui dépasse le simple dire, mais qui est chant, prière, appel, ou demande, demande d’aide. Ou souffle. Ou vie. Car, pour Cheng, la vraie voie – dit-il – se continue par la voix. Et la juste voix, écrit-il, ne surgit qu’au cœur de la voie. Ainsi, du chant poétique fait-il une aide qui nous sauvera de la mort et de l’oubli.
François Cheng est un homme âgé. Et il le sait. Et, s’il ne redoute pas la mort, il l’évoque comme une attente, comme la fin d’un long périple, comme une chose qui doit venir, un jour, bientôt, prochainement. Aussi s’empresse-t-il de louer toute chose tant qu’il le peut, et – comme saint François le faisait – de, lui aussi, remercier la pluie, le soleil, et le vent, et les morts, et les vivants, de ce qu’il est un jour passé, un bref instant, sur cette terre.
Et que, bientôt, il s’en ira.
176 p, 16,00 €
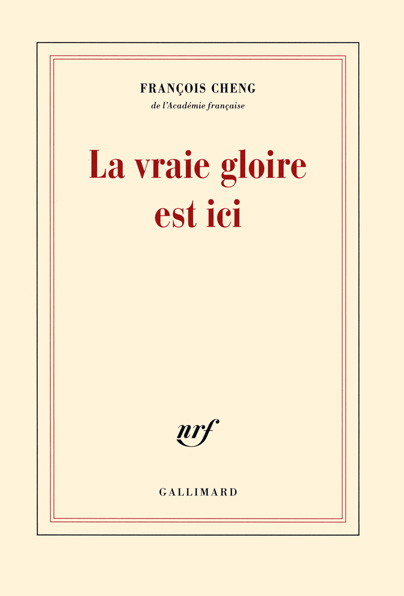
1. François d’Assise : « Cantique des Créatures », dans Anthologie bilingue de la poésie italienne, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 2-3.





