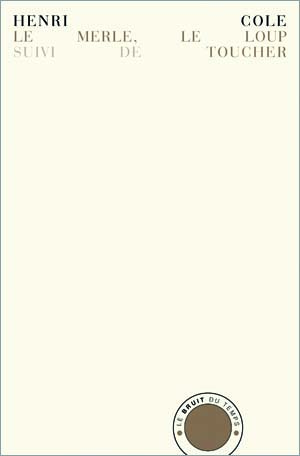par Michéa Jacobi
De la métaphysique du quotidien à la métaphysique tout court en passant par la métaphore – toujours limpide, toujours surprenante – la poésie d’Henri Cole transmet au lecteur, lassé des exercices formels prescrits par la modernité, un sentiment de plénitude qu’il n’espérait plus éprouver. Le vent parle à la mauvaise herbe et la mauvaise herbe au poète, toutes les bêtes, de l’abeille « petite mendiante gluante de sang » à l’ours noir « haletant comme un athlète » dans un pommier, toutes les bêtes sont de la partie. Mais les fables n’ont jamais de morale que personnelle. Si les plantes, les animaux et les éléments sont enrôlés, ce n’est pas pour alimenter quelque sagesse générale mais pour être questionnés, consultés, consolés. L’ours est prié de descendre de son arbre pour enseigner à Henri « la foi de l’indifférent », le faucon encouragé à dévorer sa souris « comme on pince les cordes rouges d’une harpe » et les saisons sont plaintes quand il faut les plaindre : « Pauvre été, il ne sait pas qu’il agonise ». La vie de tous les jours, de tous les instants même, est là tout entière, somptueusement concentrée dans une poignée de vers. De même la vie dans son entière durée, l’autobiographie : Cole revit sa propre naissance, évoque son père vivant « dans un mausolée de vaisselle sale » et analyse « la lumière dure, cassante, gelée » des amours enfuies. Ainsi nous offre-t-il sa vie nue, et le monde nu autour d’elle.
Il n’y a pas d’autres moyens de faire vivre la poésie.