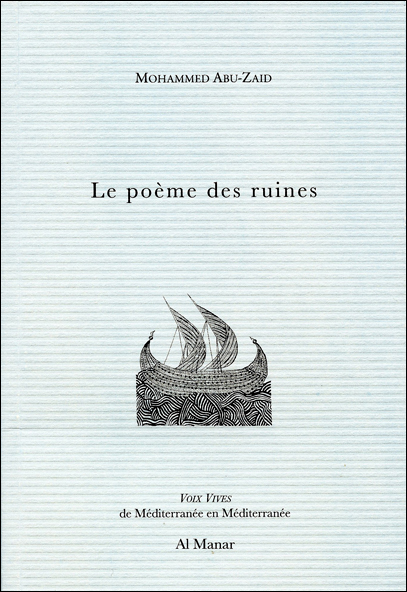par Jean-Charles Depaule
Prosaïsme, dirait-on : comme la plupart des poètes arabes de sa génération l’Egyptien Mohammed Abu-Zaïd, qui est né en 1980, parle de la vie de tous les jours, ou, plutôt, de ce qu’il reste, tout déglingué, d’une vie qui s’est éloignée. Il en parle dans une langue minimale, linéaire, où reviennent, au point d’y perdre de leur relief au profit des situations qu’ils accompagnent, les mots « ruine » et à une moindre fréquence « peur », « mort », « pleur », ou « larmes ». Se comparant pour rire à la mythique figure bédouine du poète préislamique, Abu-Zaïd, écrivain d’aujourd’hui sans tente ni cheval ni long poème, comme la plupart de ses contemporains dit la cocasserie du présent, amusante un moment, vite inquiétante. Les images ne sont pas des métaphores ni les héritières des coq-à-l’âne surréalistes, elles procèdent plutôt par association, contiguïté (Triste est mon aimée comme un lance-missiles / Le lance-missiles qui m’a tué à la guerre). Il est difficile de ne pas voir de temps à autre une allusion à des événements récents (la place Tahrir...) : La révolution était assise ici / Il y a peu dans ce café [...] // Je voudrais pleurer pour elle en vain / Je voudrais la doter d’un poème.
Édition bilingue
Al Manar
« Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée »
64 p., 12,00 €