par Yves Boudier
larevue*

Grand format, papier glacé, mise en page stricte, aucun commentaire, des poèmes, des textes, récits, journaux, des reproductions de peintures, des dessins. Une revue qui pourrait sembler austère mais dont la rigueur est tout entière au service des auteurs invités : leurs contributions sont accueillies dans un espace respectueux des formes choisies et, à la lecture croisée des différentes œuvres, une belle chaleur point, qui transcende le seul support. Quinze auteurs se partagent l’ensemble, chacun disposant d’un espace raisonnable qui invite le lecteur à vraiment entrer dans un temps de lecture et de perception intime des textes et œuvres proposés. Par exemple, le Journal 2011 de Gérard Pesson se déploie sur quelque vingt pages et emporte l’adhésion du lecteur à cette forme souvent morcelée qui s’abîme trop souvent dans une lecture elle-même papillonnante. Tel n’est pas le cas ici, comme en témoigne par ailleurs la proposition bilingue de David Mus (Directives sur / on Rome, pages inédites écrites en 1984) qui joue subtilement du français et de l’anglais mis en vis-à-vis dans une relation qui n’est pas seulement traduction mais parcours complémentaire d’un objet en quête de lui-même dans ce pli d’une écriture double. Ou bien encore le travail de Daniel Cabanis (Incendies de divers bazars) qui, non sans un humour noir ravageur, questionne avec une écriture mimant celle des médias, notre rapport au monde urbain dans ses déclinaisons institutionnelles et commerciales, de l’hypermarché au centre hospitalier, au gymnase, au cinéma, au musée d’art, jusqu’au parc d’attraction. Du côté du poème, même plaisir de lire des extraits de grande puissance, Elena Andreyev, Rémi Froger, Claude Favre, Petr Král, Henri Droguet. Une si petite remorque, texte de Pascal Commère, commence par l’évocation de sa manie d’amasser, « de rien ou de si peu », histoire de « (s)’attacher aux choses ». Ces mots pourraient très bien convenir pour qualifier cette revue dans laquelle on peut lire ce propos d’un critique littéraire allemand à qui un journaliste demandait ce qu’est un écrivain : « Quelqu’un pour qui l’écriture est plus difficile que pour les autres ». Dont acte. Dans larevue*, on mesure la pertinence de cette réponse, où le poème, au sens large, gagne sa liberté et sa profondeur pour l’Autre lecteur que nous sommes, le regard posé lentement et longuement sur les dessins de Gilles Du Bouchet et les cinq peintures de Jean-Louis Gerbaud.
Muscle

Un rectangle de 10,7 sur 14,8 cm. Couverture verte cette fois. Se déplie en un leporello de 6 pages de deux poèmes, l’un de Ben Lerner, « Répertoire des thèmes », l’autre de Hugo Pernet « Plainte ». L’ensemble peut se poser sur la table, il tient debout et offre une lecture quasi murale. On imagine s’installer dans le carré ou le triangle ainsi formés et l’on se surprend à jouer des plis, ouvrir, étirer, refermer, et « la dernière strophe s’adresse / à ceux qui n’ont rien compris ».
Europe

Consacré à Henri (Heinrich) Heine et Nelly Sachs, un important volume dans l’heureuse et sérieuse tradition de cette revue de référence. Parmi les différentes contributions concernant Heine, on reconnaît les signatures de Laurent Margantin, Georges-Arthur Goldsmith, Theodor W. Adorno ou Thomas Mann, dont nous pouvons lire deux courts mais saisissants textes écrits en 1893 (il a alors dix-huit ans) et en 1908 sur « ce juif artiste parmi les Allemands ». Au cœur du dossier figurent plusieurs poèmes de Heine, « Le voyage de la vie » (1843), « Les tisserands de Silésie » (1844), « Le bateau négrier » (1853-54) et « Une nuit d’été… » publiés dans Poèmes tardifs (Cerf, 2003) dont les traductions, pour les deux derniers, ont été revues pour ce dossier par Nicole Taubes : « Ô mort ! Ô silence, ô toi sépulture, / Vous seuls dispensez la vraie volupté ; / Désirs et passions jamais assouvis / Sont les seuls bienfaits de l’épaisse vie ! » Coïncidence de dates, Heine meurt l’année où naît Freud, 1856. Jacques Le Rider explique en quoi Heine, « incarnation de la marginalité existentielle du Juif allemand » fut un « enjeu particulièrement brûlant dans la Vienne de Freud ». Volker Braun, lauréat du prix Heine en 1971, (rappelons qu’il fut créé par la RDA en 1956 pour le centenaire de sa mort), ironise sur la censure dont il fut lui-même victime en 1972 à propos de Heine. Jean-Pierre Lefebvre, dans un entretien avec Laurent Margantin, explique la relation de Heine, élève de Hegel à Berlin, avec la philosophie et l’histoire, sa sensibilité à l’œuvre de Spinoza, en particulier sur la question de la « réhabilitation de la chair ».
Nelly Sachs nous apparaît page 158 grâce à une émouvante photo non datée d’Anna Riwkin. Le regard légèrement levé, comme se posant derrière nous, en tranquille alerte sur l’incertitude de l’avenir. « Nous sommes (…) affectés de vivre sur terre et d’avoir pour tâche, pour terrible tâche, d’assumer la souffrance et de traverser de douleur et d’amour cet astre, jusqu’à le rendre transparent, traversé par nos dits et non-dits – cette écriture cryptée par laquelle nous rendons lisible (…) un univers invisible », déclare-t-elle en 1960 à l’occasion de la remise du prix Annette Von Droste-Hülshoff à Meersburg. Saluée dans la deuxième moitié des années cinquante par Paul Celan, Ingeborg Bachmann et Hans Magnus Enzensberger, l’apatride Nelly Sachs, exilée à Stockholm depuis 1939, prit la citoyenneté suédoise en 1952. Elle ne revit furtivement Berlin, sa ville natale, qu’en 1965, obtint le Nobel en 1966, s’éteignit à Stockholm en 1970. L’entretien avec Mireille Gansel, à qui l’on doit la traduction de l’œuvre poétique de Nelly Sachs chez Verdier (1999-2002-2005) ainsi que celle de sa correspondance avec Paul Celan (Belin, 1999), est d’une grande précision sur les enjeux de la traduction, de la nécessité « de rendre perceptible, dans le corps de la langue, ce que l’autre langue nous dit », comme le souligne Barbara Agnese. Par ailleurs, Lucie Taïeb établit un lien subtil entre l’œuvre de Nelly Sachs et celle de Paul Klee, peintre d’un « monde où le désastre n’a pas encore eu lieu ». Quelle consolation cherchait-elle dans ces toiles apaisées, « là où le parfum du santal / déjà plane sans bois, / où le souffle continue de construire en cet espace / qui n’est que de seuils franchis / (…) ci-gît mon ombre / main de la nuit, // qui avec l’esprit de traque du chasseur noir / a tiré / sur l’oiseau rouge du sang ».
Suivent les habituelles chroniques, en particulier celle d’Olivier Barbarant consacrée à Titos Patrikios, Les gisements du temps. Sans oublier les quelque quarante pages de Notes de lecture, indispensables.
N 47
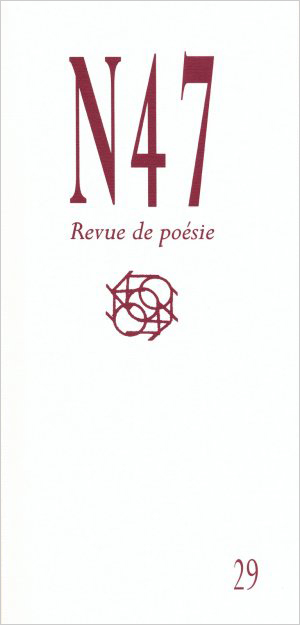
S’ouvrant avec un poème d’Ashraf Fayad, extrait d’Instructions de l’intérieur, publié en 2007, la revue manifeste son soutien au poète palestinien condamné à la prison et au fouet pour « apostasie » par la justice du Royaume d’Arabie Saoudite. Elle se divise ensuite en plusieurs temps : Pleins formats accueillent Myriam Eck, Marcel Migozzi et Michel Thion, Plurielles invitent quelque quinze poètes, large éventail d’écritures nouvelles et en recherche d’elles-mêmes. Sentiers convient les auteurs à faire partager leur réflexion, cette fois sur le thème Le blanc et / ou le silence dans le poème. Ainsi Matthieu Gosztola, Ludovic Degroote, Antonio Rodriguez, Serge Ritman (Salut Martin !), Jean-Patrice Courtois, James Sacré et Christian Vogels traversent-ils les œuvres de Mallarmé, Reverdy, Antoine Emaz ou André du Bouchet ; ainsi tangentent-ils Martin Heidegger, Georges Didi-Huberman, Jean-Luc Nancy ou Jacques Rancière, en dialogue avec leurs propres poèmes, allant du blanc absence, écriture du silence, au blanc morphologique des mots, à l’espace laissé entre les vers, à l’entour de la marge et du poème. Puis, les notes de lecture, parmi lesquelles Sereine Berlottier pour son magnifique Louis sous la terre (Argol, 2015).
Lignes
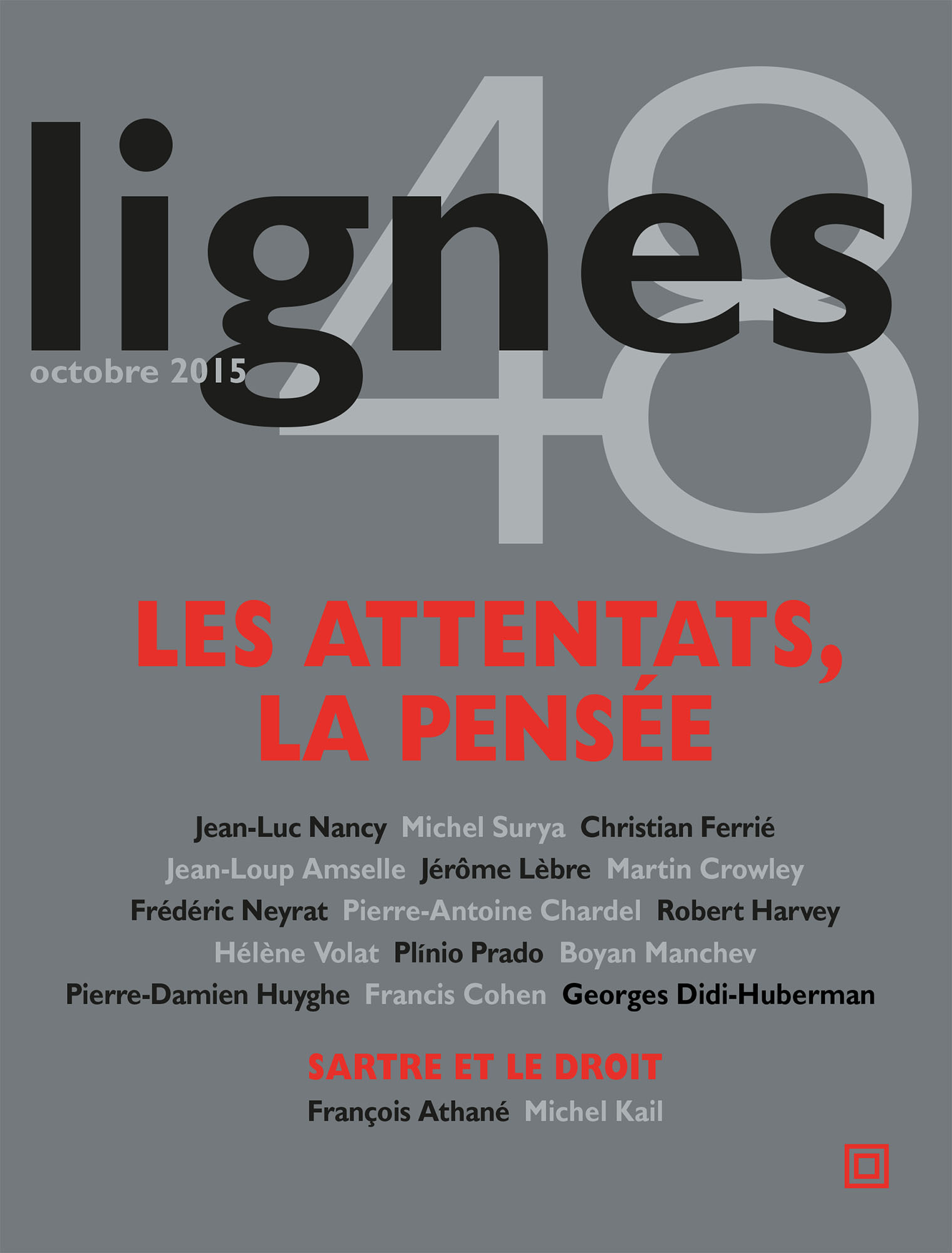
Introduit par un éditorial qui avance plusieurs pistes de réflexion sur les récents attentats pour cerner la question « de départ » à laquelle les contributions de ce numéro tentent des réponses, cet ensemble de treize articles s’ouvre avec Jean-Luc Nancy pour se refermer avec Georges Didi-Huberman. « Une césure opérante semble se dégager : ce serait selon que le capitalisme est premier ou second dans l’analyse, que s’établiraient les pensées et se distribueraient les déclarations ». Telle se formule l’hypothèse sur laquelle se fonde ce travail collectif. Les rapports de force aujourd’hui ne sont-ils pas en train de changer « au point que penser selon les termes des puissances respectives du capitalisme et de son opposition ne suffit plus » ? Quelque chose d’autre « émerge qui ravage des territoires entiers, y répandant la terreur, qui n’est sans doute pas moins hostile à l’anticapitalisme qu’au capitalisme lui-même ». Ne serait-on pas face à « une variante (contemporaine) du fascisme » ? Le parcours s’effectue par déconstructions puis propositions conceptuelles autour des notions de « commun », « révolution du sens et mutation de civilisation », « injonction au jouir et passion ascétique identitaire », « islamisme politique radical et irréligion révolutionnaire », « antiterrorisme et libertés », « respect ou non d’une prétendue sacralité », « conflit identitaire, laïcité et reconnaissance de la différence », jusqu’au retour de la question du sujet au plus intime d’une identité déniée et d’un corps meurtri qui appellent un « soulèvement », au sens le plus fort, le plus émouvant, comme on le ressent dans les pages consacrées à Simon Fieschi par Georges Didi-Huberman, l’une des victimes, cependant vivante, de l’attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Elles suivent la réflexion critique de Francis Cohen sur « Le nom juif, le verbe juif » ; il fait siens les propos de Marcel Duchamp « qui n’offre pas de réponse à la question juive, parce qu’elle est au cœur du sujet de la parole ».
Mots Slow
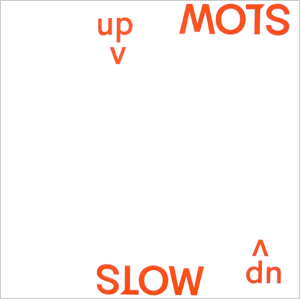
Cette revue récente, fondée par Jérôme Karsenti et publiée par Hand Art Publisher, paraît chaque année un jour avant l’édition précédente. Le premier numéro est ainsi sorti le 1er décembre 2013, le deuxième le 30 novembre 2014, et l’on sait qu’il n’y aura « que 364 Mots Slow, la dernière parution étant prévue le 30 novembre 2358. (…) Chaque numéro est conçu comme une œuvre collective où effets plastiques et d’écritures se conjuguent à travers la participation d’artistes, de scientifiques et de littéraires. La revue est imprimée sur un format papier 110 gr, recto verso, 70 x 100 cm, que l’on pourra plier au format 21 x 30 cm de sorte à sélectionner « l’article », l’œuvre de son choix, ou à les juxtaposer. Le poster sera susceptible alors d’être encadré. Le graphisme est modifié à chaque numéro, en fonction du thème choisi. La revue est un espace fantaisiste, « fontaine où les grotesques regardant leurs reflets ondulés se trouvent apprêtés ». Nous voici informés sur le projet et son impensable et joyeuse pérennité. Dix-sept intervenants pour cette livraison, inventive et respectueuse des préceptes énoncés plus haut. L’intelligence du dispositif, au sens le plus concret, offre des manières de lectures, de perception des propositions graphiques très excitantes. Rapidement, on se perd dans ces plis selon plis, et cherchant des liens, tentant de trouver le dépliement idoine, on est surpris par le surgissement du texte et de l’image. C’est un jeu simple et à la fois complexe qui instaure une modalité polymorphe de lecture(s), de captation du sens plus encore.
La Revue des revues

Selon Emmanuel Laugier, publier en revue « appelle autant un relativisme certain par rapport à soi, qu’une volonté d’affirmation que l’on se voudrait reconnaître ». Ce double sentiment serait dû au fait que la revue « désindividualise la lecture » et promeut une « lecture articulaire », pour reprendre les termes de Michèle Cohen-Halimi. Cette schize entre « le sujet de l’autorité (l’auteur) et ce qu’il donne à lire » offre à la lecture un statut particulier, celui de placer l’auteur face à la mémoire de la langue avec la création renouvelée qu’une publication en revue tente d’incarner. Cette réinvention de la « passion de la transitivité » propre à la publication en revue est d’importance.
En témoigne quasiment l’ensemble de ce numéro 53 qui présente un très important dossier, « Des amis et des savants. Une enquête sur les publications des sociétés littéraires » signé par Guillaume Louet, ces revues et bulletins d’amis d’auteurs qui luttent contre l’entre-soi des sociétés secrètes et élargissent la communauté des lecteurs savants. Depuis 1794, avec l’apparition d’un nom d’auteur, J.-J. Rousseau en l’occurrence, dans l’intitulé d’une société littéraire, en passant par une fin dix-neuvième prolixe et les années de l’entre-deux guerres, c’est véritablement à partir des années cinquante que se crée un très grand nombre de ces publications. Lautréamont, J-K. Huysmans, Gide, Claudel, Giono, Paulhan, Romain Rolland, Giraudoux, Colette, Valéry, Jules Romain, Bloy, Bernanos, Péguy, Buzzatti, puis Max Jacob, Henri Bosco, Robert Margerit, Benjamin Fondane, Rémi de Gourmont, Jean Prévost, Claude Simon, Benjamin Péret et Louis Calaferte… font l’objet d’études et de publications régulières, universitaires et le plus souvent amicales. Vivier pour les curieux et les spécialistes, ces bulletins constituent un trésor où des recherches se mènent, des thèses s’inventent.
À signaler par ailleurs l’hommage sensible rendu à Charles Dobzinski par Pascal Boulanger, à sa lucidité et à son courage politique dans les années grises du stalinisme ; l’entretien avec Philippe Lejeune sur sa revue consacrée à l’autobiographie La Faute à Rousseau, celui des Confessions bien sûr ; ou l’intéressante chronique de Sylvie Mokhtari à propos de l’ouvrage de Fabienne Dumont, Des sorcières comme les autres. Artistes et féministes dans la France des années 1970 (PuR, 2014), une étude fondée sur un corpus important de revues d’art. Saluer enfin la création d’une nouvelle revue, Incise, qui, depuis le théâtre, souhaite interroger notre époque : « qu’est-ce qu’un lieu ? », métaphore de la question politique et affirmation de la « nécessité de la chose commune ».





