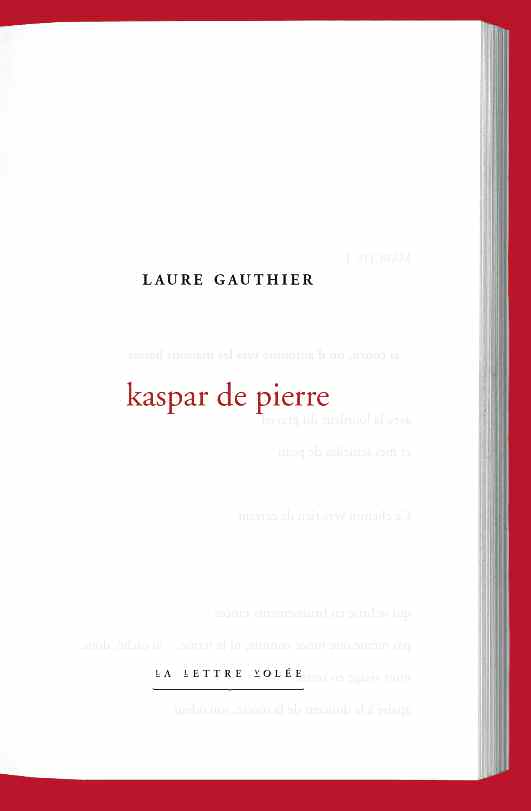par Bernard Banoun
Ce nouveau livre de Laure Gauthier, dans la lignée de marie weiss rot / marie blanc rouge (Delatour, 2013) et La Cité dolente (Châtelet-Voltaire, 2015) – et si l’on excepte ses nombreux livres et travaux universitaires qui, en particulier par ses recherches sur la musique et l’intermédialité, ne sont pas distincts de sa production poétique, car les vases sont communicants –, fait vivre au lecteur une expérience de poésie théâtrale, ou de théâtre poétique, voire de fusion entre le récit, la poésie et le théâtre. Et à cette alliance entre les genres se combinent d’autres superpositions complexes dont on pourrait dire qu’elles permettent l’avènement d’une écriture européenne intermédiale et expérimentale : une sorte d’œuvre d’art totale, non dans la démesure wagnérienne, mais dans la concentration.
Laure Gauthier joue ici des contraires, entre offrande et rétractation, entre mystère et évidence : il y a là des expérimentations verbales – les sujets grammaticaux, première et troisième personnes, ne sont souvent marqués que par J ou Jl ou bien le je est non seulement tronqué mais carrément absent et marqué par un blanc (ce « blanc d’absence », dit le texte) ; la typographie – dispositions en versets ou courts paragraphes, blancs – contribue à l’effet synesthésique du texte : il se voit et s’entend déjà, des accumulations consonantiques opèrent à même la page la transmutation de la lecture en audition, des formulations emportent par leur beauté qui tient aussi de leur énigmaticité. Et pourtant, face à cela, la construction du texte, fondée sur les mythèmes de Kaspar Hauser, livre un fil au lecteur : l’enfance sauvage, Nuremberg, les stations, l’enfermement et l’exhibition publique (les scènes « Maison » et « Rue »). Résolument moderne, le texte revivifie l’imaginaire du personnage ; décanté, il porte les images d’un monde passé.
L’une des manières possible de qualifier ce texte serait : partition théâtrale. Car kaspar de pierre présente une succession de scènes qui ne vont pas sans rappeler l’agencement des scènes dans Woyzeck de Berg ; chez Berg, l’opéra compte quinze scènes ; l’opéra scriptural de Laure Gauthier est consacré, lui, à un autre marginal sur lequel pèsent les regards et discours inquisiteurs et régulateurs (deux scènes portent pour titre « Diagnostic ») et en compte 11 : un nombre premier, et surtout juxtaposition de deux 1 qui sont comme un redoublement de l’unicité et de la solitude essentielles de Kaspar.
Dans une tradition de textes, fortement soudés entre eux, de la poésie européenne (Verlaine, Trakl), mais une tradition renouvelée, et sous la plume d’une autrice, ce kaspar est dans son absence même cette figure en deçà du langage et sujet objet de la poésie : « Muré = sans expérience = cœur pur = verbe premier = poésie » ; dans sa nudité, l’infans est page blanche, écran, surface de projection d’autres suicidés de la société (le jaune des tournesols : « Jl courrrr tronqué vers le champ toujours à nouveau de tournesols »), et il est celui qu’on remplit « des copeaux de tous les ébréchés ». Par là il est aussi, entre le silence et une réalisation verbale précaire ou forcément excessive, comme une instance critique de la poésie, accusateur du « marché de la poésie ». Ainsi, au-delà de la beauté du texte et de l’évocation du mythe poétique contradictoirement incarné par Kaspar Hauser entre humanité et animalité, le livre de Laure Gauthier, relecture enrichie et plurielle de ce mythe, apparaît comme nourri d’un savoir intégrateur. La dernière scène s’intitule non sans ironie « résumons-nous » et se termine, ou plutôt s’ouvre, sur une adresse au lecteur, sur une histoire de communication et d’incommunicabilité, le je toujours absent, mais la bouche présente : « Ma bouche pleine de vos mots, suis une histoire, ».