par Christian Travaux
La langue s’est asséchée, rétrécie, réduite à l’os. Ne reste, parfois, qu’un squelette, quelques mots, et même pas de phrases achevées. Une voix qui bute. Et qui lutte. Et qui tâtonne dans ce noir et blanc de la page, qui cherche à être, ou qui, soudain, se lâche en prose, tas de prose, petits tas sombres, où les mots, les phrases, viennent, s’enchaînent, se succèdent, se télescopent. Plus de suites vraiment non plus. C’est-à-dire de textes sous un sous-titre : « Trop », « Seul », « Corde », « Vert », comme encore il y a peu dans Peau, Plaie, Poèmes pauvres.
Rien de cela, ici. Des textes unis par une date, groupés dessous, et rassemblés comme un moment d’écriture sauvé des eaux. Extrait du naufrage d’une vie qui dévisse, va vers sa fin, atteint sa limite, et finit. Limite, ainsi, répond bien au souhait d’Emaz d’écrire la fatigue de vivre, l’épuisement, ou le faix de l’être. Depuis quelques années déjà, il n’écrit plus de poésie. Des carnets. Des livres de notes, Cambouis, Cuisine, Flaques, ou Planche. Où s’avoue une poésie comme en quête, comme en attente. Une eau qui fuit dès qu’on l’approche. Un visage qui se détourne. Un désir vain.
Pourtant, Limite est bien un livre de poèmes, comme il y en a peu dans tous les ouvrages d’Emaz. S’y essaie une voix qui tremble, un pas qui chancelle dès le seuil, qui hésite à retourner d’où il est venu, d’où il est sorti. Qui, conscient – sans doute avec l’âge – de la vanité, la faiblesse, du langage, se désavoue au moment même où il s’écrit. Abandonne. Parfois, s’arrête. Plante là, tout. Et renonce, quand il écrit, à aller plus loin, plus avant, faute d’espace, faute de désir, faute d’envie de continuer. À quoi bon donc ?
Mais qui risque, qui continue, qui cherche malgré tout à se dire, ou à dire cette faiblesse, cette vanité d’être au monde, de durer, ou cet abandon. Qui veut persister, et décrire la fatigue, le renoncement, mais aussi la vie quotidienne : la cuisine, la véranda, l’évier, la machine à laver, le formica. Et toute l’existence ordinaire qui se dit en « on », en sourdine, à demi, à l’infinitif. Ce qui ne s’avoue pas facilement, comme l’alcool, la maladie, l’ennui, l’habitude, l’attente. Tout le corps, qui n’est plus fiable, qui voit, qui entend, qui remarque l’alentour, mais qui faut, parfois, trébuche, et lâche.
Et c’est en cela qu’il émeut, sans doute, qu’il touche le plus. Car Emaz dit là l’essentiel de nos vies, notre quotidien, ce qui fait le flux de nos veines, nos artères, la palpitation de notre cœur, de notre pouls, et l’usure de notre corps. Il dit, ou marmonne à mi-voix ce que chacun dit entre soi, dans la closerie de son être. Ce petit discours intérieur que l’on se tient quand on est seul, face à soi, face à soi toujours, et qu’on veut résister quand même à ce qui vient, à ce qui cède, à ce qui nous arrive tous les jours. Et qu’on ne peut pas.
Aussi, est-il un peu dommage qu’Un Nouveau Monde1, l’anthologie d’Yves di Manno, Isabelle Garron, sur cinquante ans de poésie contemporaine, ait ignoré cette écriture si singulière, cette présence, tout à l’écoute de ce qu’on est, de ce qu’on vit.
Cette voix majeure.
176 p., 15,00 €
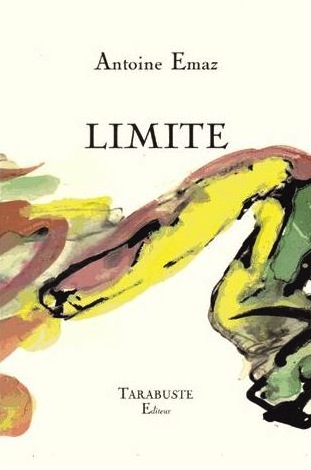
1. Yves di Manno, Isabelle Garron : Un nouveau monde. Poésies en France, 1960-2010, Flammarion, « Mille & une pages », 2017. Une simple liste de titres, p. 1494, comme Paul de Roux, Jean-Michel Maulpoix, sans parler de l’absence, inexplicable, de Jacques Ancet et de Philippe Jaccottet.





