par Christian Travaux
D’Une Main cachée dans un tiroir, il faut retenir la date. 1999. Une fin de siècle. La fin d’un monde. Quelque chose qui disparaît, dont on n’eut pas conscience sans doute, tout de suite, mais qu’on voit maintenant perdu, et pour toujours. L’impression d’un temps achevé, d’une porte à jamais refermée, et de morts qu’on a dû laisser sur le chemin d’un autre siècle.
Ainsi Pilar González España, qui, dans ce livre seulement traduit aujourd’hui, dit la peine de vivre, la sensation crépusculaire d’exister, la solitude d’être, et le sentiment obsédant que quelque chose s’est écroulé, comme un mur, à ce moment-là, dans nos vies, de notre existence, qu’il nous faut essayer d’écrire. Un bilan. Le constat d’une vie qui s’avance déjà vers sa fin, mais qui a laissé, en passant, se déroulant, un tas de morts, un tas d’ombres, comme des fantômes, qui ne nous laissent pas tranquilles. Une petite fille, toute seule, toujours toute seule, dont les mots sont seuls compagnons, pour leur bruit, pour les voix qu’ils disent. Une voix, ou des voix, ou des mots, tant de voix, de choses dans l’air, et tant d’yeux, tant de mains tendues, qu’on voudrait rassurer un peu, qu’on ne peut pas. Et une femme, qui regarde, assise, qui elle fut, qui elle a été, et qui elle est dorénavant que les ans tournent sur leur socle, et quels êtres la hantent encore.
Dans une alternance prose / vers, ce recueil évoque la douleur – le goutte à goutte de la douleur, écrit l’auteur –, la terreur ou la solitude comme unique terre où creuser, et les larmes comme source obscure. Ni air. Ni lumière. Et pas plus d’oxygène, dans cet espace, où tout le corps devient espace : des fenêtres, les trous du corps ; un plafond, la tête ; et les yeux, de la pluie, de la nuit qui vient ; un sol, des pieds. Tout est nuit, et tout est obscur. Et c’est dans cette obscurité qu’on doit vivre, qu’on doit durer. On va à l’aveugle, incertain, en tâtonnant, dans notre vie, et frappant contre des parois comme autant de portes fermées. On dit qu’on va. Mais on ne va pas. On cherche encore, incapable de sortir de soi, de tout l’intérieur de notre être, quand notre être est murs, est fenêtres, est jardin, est chambre, est étoiles. Que l’univers s’écoule en nous. Et que notre unique désir est de comprendre, dans tout cela, ce qui aide, ce qui peut sauver.
Les mots seuls, en fait, peuvent sauver – dit Pilar González España – de ce qui nous porte, malgré nous, et nous emporte. Seuls les mots peuvent dire ce qui parle à l’intérieur de nous, en nous, malgré nous, presque contre nous. Dire ce que disent ces voix internes (nos fantômes, nos lâchetés, ou nos erreurs laissées en route). Toutes ces choses que l’on entend, que l’on pressent, que l’on ressent, et qui dialoguent quand on est seul. Et seuls les mots, déclare l’auteur, ont ce pouvoir de dire « pluie », et qu’il pleuve, de dire « nuage », et qu’un nuage passe soudain, de dire « autre » et que l’autre naisse. Seuls les mots ont pouvoir de vie, dans cette noirceur où nous sommes. Ainsi nous faut-il désécrire, dé-penser, dé-dire, et encore dé-respirer, comme dit l’auteur, pour que, sortie du tiroir qui est nous, où elle fut cachée, paraisse et se tende une main, une main, une main vivante comme chez Rilke dans Malte Laurids Brigge1, à qui, enfin, tendre la main.
Et nous sauver.
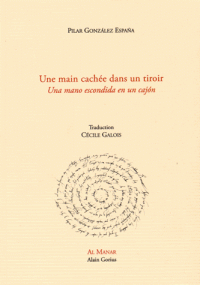
1. Rainer Maria Rilke : Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, traduit de l’allemand par Maurice Betz, Points / Seuil.





