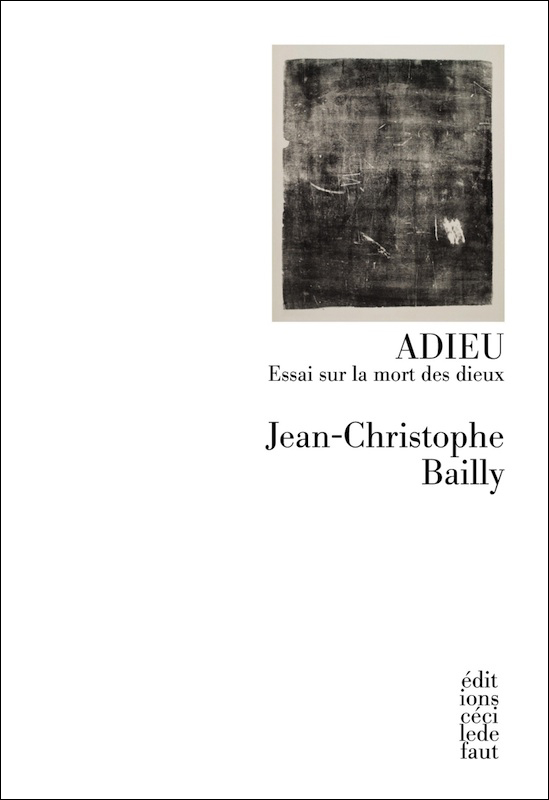par Stéphanie Eligert
Jean-Christophe Bailly déploie les deux essais qui composent ce livre à partir de cet extrait du Gai savoir de Nietzsche : « Dieu est mort. Mais tels sont les hommes qu’il y aura encore pendant des millénaires des cavernes dans lesquelles on montrera son ombre… Et nous… Il faut encore que nous vainquions son ombre. » De là, Bailly et son intelligence sensible, se saisissant d’une idée comme d’une chose concrète existant physiquement dans le monde, cherche à comprendre « de quoi est faite cette ombre – dans le religieux lui-même, mais aussi dans la politique ». S’ensuit une première analyse, questionnant la matière de cette « ombre » chez les Dieux grecs, puis le Dieu chrétien. L’interrogation centrale, et splendide, est alors la suivante : « Nous vivons donc sans Dieu ni dieux, mais cette vie qui devrait être surprenante, étonnée, nouvelle, semble à peine consciente. Tout se passe comme si cette absence allait de soi, comme si elle ne nous convoquait pas, elle aussi, autour d’une aire à remplir, de contenus et d’idées » (p.16). Or curieusement, très vite, cette « aire » – au lieu de libérer une immanence intégrale, dont l’intensité serait encore vivifiée par la conscience, puis l’évaporation, des quelques résidus d’« ombre » pesant encore ici et là – devient le lieu d’une « sépulture » donnée à Dieu et aux dieux – « tombeau » qu’est en quelque sorte ce livre. Sans doute est-ce normal dans une logique de deuil, mais cela crée une certaine frustration puisque c’est ainsi la fraîcheur d’un sentir-être sans dieu(x) qui est esquivée, ce « tombeau » venant paradoxalement épaissir « l’ombre » qu’il s’agissait pourtant, au début, de complètement dissiper. Tout cela est beaucoup plus aigu dans le second essai, très beau, qui s’appuie sur un texte de Plutarque – La Mort du grand Pan – qu’à raison, Bailly qualifie de « plus troublant jamais écrit sur la mort d’un dieu ». En voici un extrait : « Il n’y avait plus un souffle d’air, pas une vague. Alors Thamous, placé à la poupe et tourné vers la terre, dit, suivant les paroles entendues : “Le grand Pan est mort”. À peine eut-il fini qu’un grand sanglot s’éleva, non poussé par une, mais beaucoup de personnes, et mêlé de cris de surprise ». Là où Bailly – au terme d’une enquête philologique très fine – décide, non sans mélancolie, de retourner sur les lieux méditerranéens d’où cette mort a été annoncée pour sentir les ultimes vibrations de ce « grand sanglot », qui est comme « embouti dans les choses », de notre côté, nous arrêtant à ce seul texte, ce sont les « cris de surprise » mêlés aux pleurs qui retiennent l’attention. À elle seule, cette « surprise » dit déjà adieu aux dieux et dénote la joie pré-nietzschéenne de s’élancer dans un monde devenu horizontal, nouveau et beau.