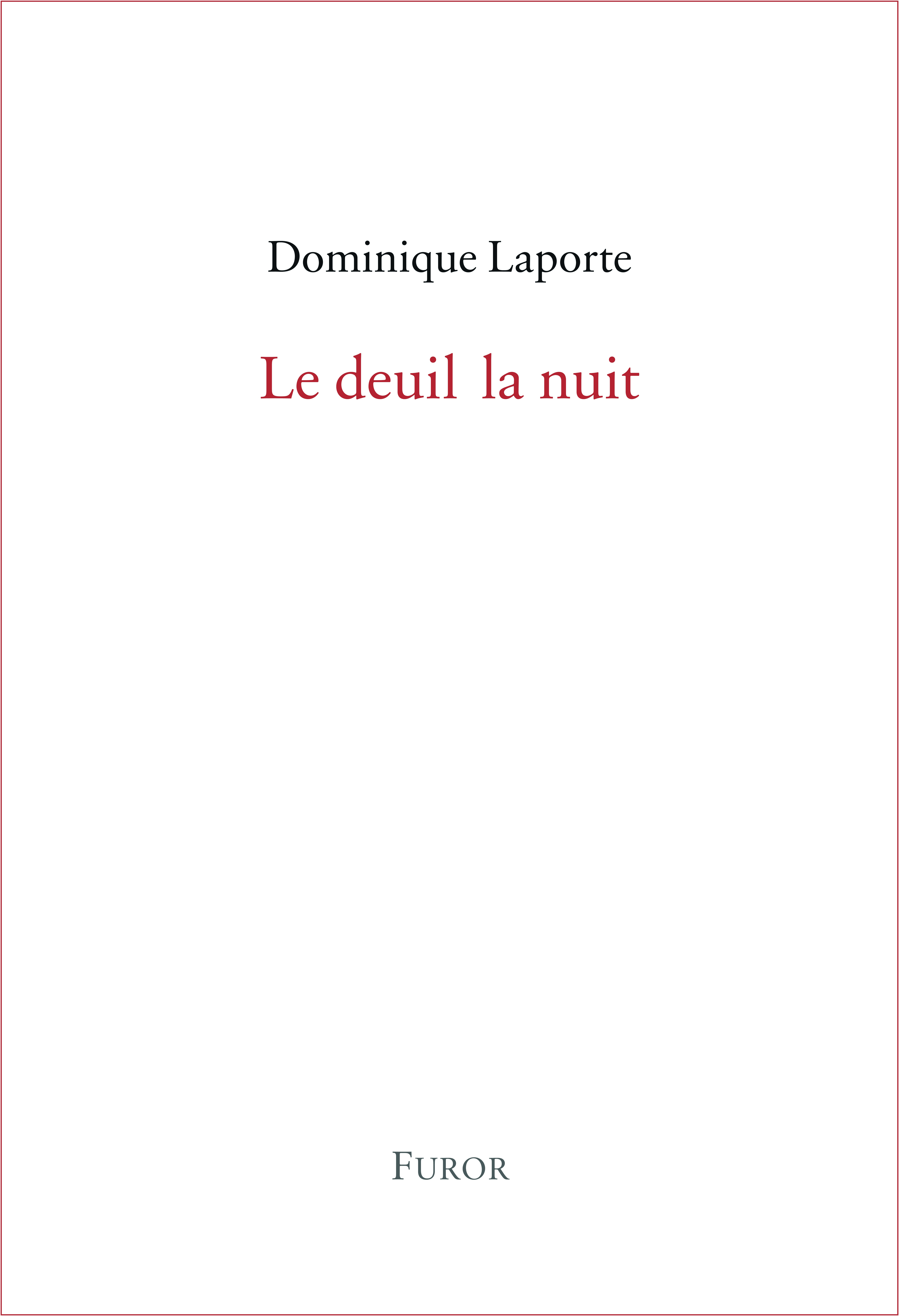Par Anne Malaprade
Les essais qui composent Le deuil la nuit, deuil qui est aussi le nôtre – Dominique Laporte est décédé en 1984 à l’âge de trente-cinq ans – rassemblent des textes parus originellement dans les cahiers Argo et la revue Furor. Ils furent réécrits en 1983, réorganisés, pensés selon la perspective générale du travail de celui qui se pencha, depuis Histoire de la merde, paru chez Bourgois en 1978, à la généalogie de l’opprobre : le déchet, l’excrément, les matières viles et mortes, le bas corporel, le pourri et la crasse, autant de motifs ignobles et impudiques dont l’écrivain souligna la surprenante souveraineté. Prologue (introduction d’une vaste recherche, autant qu’exposition d’un sujet tragique) que l’écrivain signe ici depuis sa mort, puisque cet ensemble paraît donc à titre posthume.
Le premier essai s’ouvre sur une voix défaite : « Sa mort me laisse sans voix ». Essayons de trouver une voix écrite pour dire la justesse de cette voix d’outre-tombe signant une série d’articles graves mais jamais pesants, érudits mais jamais cuistres, dont la profondeur n’a d’égale que la nécessité. Cette voix-de-l’écrit est magnifique : tenace, perspicace, avertie, obstinée, elle dit la loi et sa transgression, le silence et le tumulte, la beauté et la souillure. Autant de thèmes hérités de Sade ou de Bataille auxquels Dominique Laporte apporte une écoute qui est aussi un miroir, une attention qui révèle avant tout une langue dont la structure est d’autant plus classique que son propos veut obscéniser – mettre sur scène, sous nos yeux – toute une part anomique du réel que la réalité sociale s’efforce de refouler. Méditation donc, sur la voix du mort, dont la prosopopée ne peut que fasciner les survivants que nous sommes. Promenade, ensuite, dans l’ombre des corps ; dans les noms propres, qui sont parfois des signes d’autant plus blessants que la langue leur octroie, d’emblée, un sens. Voix, corps, nom : autant d’indices que la littérature s’approprie pour approcher les fantômes, pour traverser les phantasmes, pour que s’écrive l’origine avant que ne se vive la fin. Une deuxième section étudie les encres bleues de Laure et revient sur L’Éducation sentimentale, dont les lectures traditionnelles écrasent l’étrange point de vue. Flaubert, en effet, n’écrit pas depuis le principe de réalité, et refuse de contraindre son personnage à vivre dans le sens du monde social. Frédéric perd, lâche, abandonne, décapitalise, dépense, désapproprie et se désapproprie. Il extravague, et flotte dans le monde réel, ce que ses lecteurs et ses critiques ne lui pardonnent pas. C’est un raté du seul point de vue de la réalité. Au-delà de la réalité, à côté de la réalité, le désœuvrement de Frédéric constitue bien au contraire une expérience unique et totale, qui se nourrit du vide, de la faille, d’un désastre qui permet à l’écriture de faire entendre la langue pour elle-même, « pure et sans aucun bruit ». Enfin, Dominique Laporte signe un art poétique, « Il nous reste la main », qui constitue un blason du corps aussi intense que désespéré. L’organe apparaît à la jonction du corps et de l’esprit. Il est ce par quoi la matière se vocalise, ce par quoi elle s’allège et se subtilise. Oubli et mémoire du corps, la main écrivant, la main écrite, la main écriture semble un outil sacré : ce par quoi le sujet travaille à son salut, et au salut de l’humanité. La main, vive ou morte, se tient au bord d’un abîme à partir duquel le réel semble toujours au-dehors et au-delà de la raison. Elle est douée d’une qualité mystérieuse qui s’apparente à ce que d’aucuns appellent la grâce.