par Christian Travaux
Qui donc lit aujourd’hui Swinburne ? Qui donc s’en préoccupe encore, sinon en ayant su, un jour, qu’il fut un nom – pour Mallarmé – poétique, qu’il en fut l’ami, pour qui il écrivit un texte en français, ou que Mallarmé admirait beaucoup son œuvre, et que Maupassant le sauva d’une noyade, en Normandie, et qu’il retira d’un dîner excentrique, avec ses amis, sa nouvelle « La Main d’écorché » ? Qui, en France, le connaît encore, excepté l’Université, et quelques amateurs choisis ?
Sans doute, Swinburne aurait goûté cette discrète célébrité, lui qui, en son temps, fut célèbre, peut-être pour de mauvaises raisons. Dès Atalante à Calydon, en 1865, et par ses Poèmes et Ballades, parus tout aussitôt après, Swinburne fait connaître son nom et son œuvre avec scandale. Accusé d’excentricité, d’un goût pour les débordements érotiques, sadomasochistes, il est, d’emblée taxé d’auteur sulfureux par l’ère victorienne. Et cette aura ne le quittera plus. Même quand il se rangera, plus sage, à une poésie plus formelle, plus classique, moins tourmentée.
Car ce qui caractérise les vers de Swinburne, dès le début, c’est cette écriture affolée, aux phrases longues, aux méandres d’où jaillissent, à chaque angle de strophe, des images, un trop plein d’images, une luxuriance d’images, comme une plante à fleurs tropicales. Parfois, quand le phrasé s’allonge, c’est un bondissement perpétuel de métaphores, d’analogies, qui se met en œuvre, laissant place à un monde rêvé, embelli, à un univers transformé, tellurique, fantasmagorique. Et, d’autres fois, la phrase s’allonge tellement, le vers se brise, la rime se maintient en suspens, au centre de deux enjambements, et le chant cherche les sommets.
Swinburne adopte « l’art pour l’art », non pour seulement – comme dit Gautier – que
« l’œuvre sort(e) plus belle
D’une forme au travail
Rebelle
Vers, marbre, onyx, émail »1,
mais pour rendre plutôt le mouvement des éléments, l’eau de la mer, le bruit du vent, et l’air de l’air, avec toute la respiration, l’amplitude du chant, de la voix, et la volupté même des choses.
C’est cela qui a dû frapper, choquer, ses contemporains. Cette façon suave de dire, tout en retardant le moment où l’on dit et où l’on va dire, cette attente inquiète, sensuelle, érotique, presque jouissive, où l’on savoure le fait de dire et d’écrire, par plans successifs d’adjectifs, énumérations, et préliminaires rhétoriques. Ou cet amour, au sens le plus charnel du terme, pour la langue et pour la métrique, pour sa sonorité autant que pour son sens et pour ses mots. Une extase de la parole, qui suit chaque succion de poèmes, murmurés comme autant d’aveux amoureux, que l’on fasse parler Rosamond ou Marie Stuart. Mallarmé ne s’est pas trompé, en reconnaissant en Swinburne un amateur du pur langage, de
« cette écume vierge vers
À ne désigner que la coupe »2.
Aujourd’hui, il en reste encore – à le lire – toute une inventivité stupéfiante d’images et de sonorités inouïes, toute une production poétique de grand intérêt, dont l’édition Corti rend compte très imparfaitement. Une préface passionnante, certes, mais aucune note, rien, pas une ligne pour expliquer que tel poème n’est qu’un extrait de tragédie, et tel autre une seule partie d’un poème plus long, plus complexe. Rien non plus, éclairant les noms convoqués, ou les allusions énigmatiques fort nombreuses. Cela, à lire, rend plus encore un sens étrange et décadent, qui ne messied pas à Swinburne. Mais le lecteur s’en sent exclu, parfois.
Et les textes se referment sur leur énigme et leur beauté.
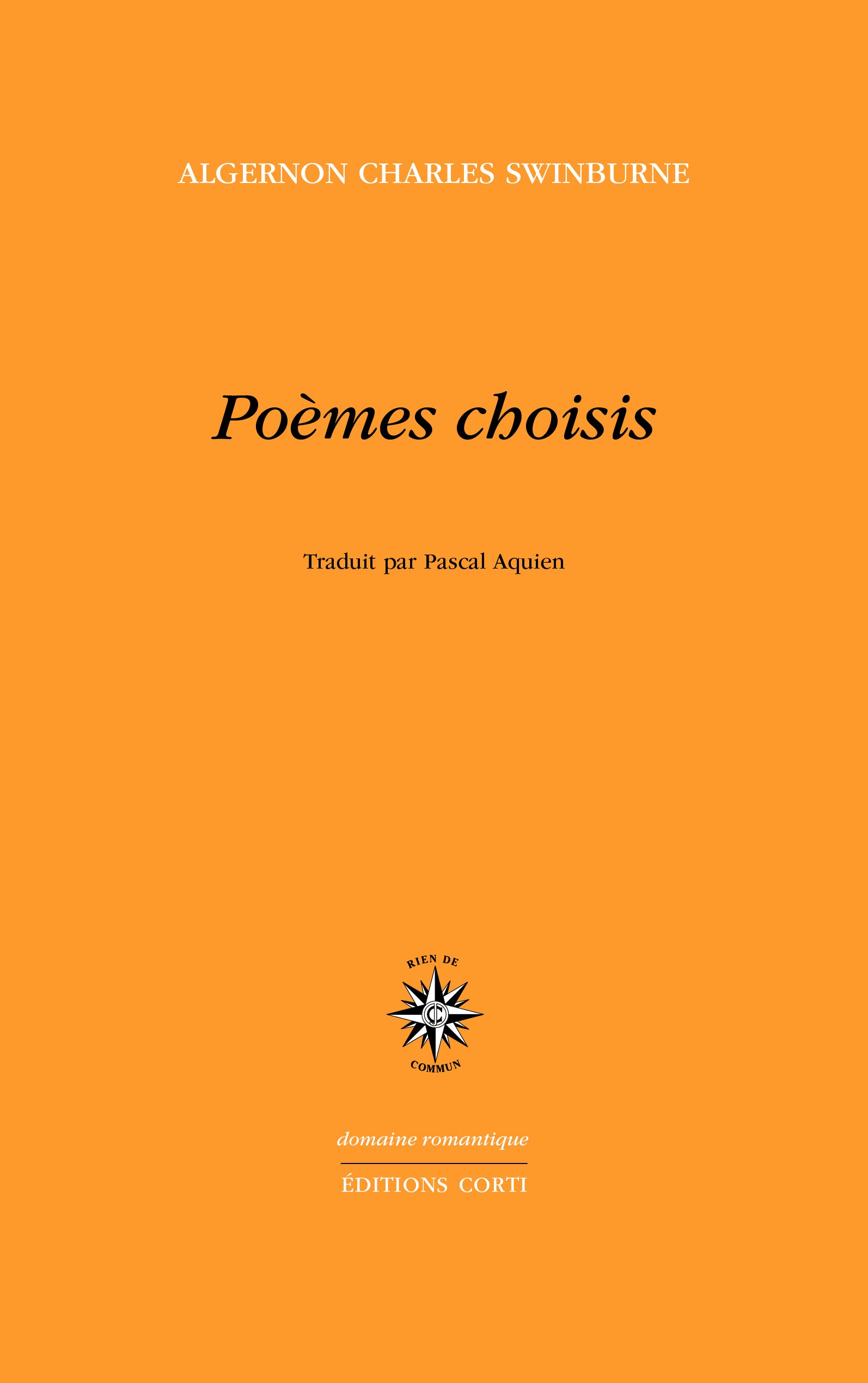
1. Théophile Gautier : « L’Art », dans Émaux et Camées, 1852.
2. Stéphane Mallarmé : « Salut », dans Œuvres complètes, I, « Bibliothèque de la Pléiade », p.4.





