par Christian Travaux
À les lire, on dirait Les Elégies de Duino de Rilke. Même ampleur, même hauteur de vue, même volonté de crier « d’entre les ordres des anges »1. Même mouvement impulsé par un lieu, une situation de détresse ou d’enfermement, une vie précaire. Et même orage dans la parole. Car, d’emblée, le ton est donné de tutoyer les immortels, de parler avec les nuages, ou d’échanger avec la foudre, et voir plus loin et plus avant.
Pourtant, l’enjeu est différent, et les circonstances d’écriture de ce livre particulières. En 1939, Riba doit fuir l’Espagne de Franco, plus exactement Barcelone où il professe les langues anciennes, et défend la Catalogne. Dès janvier, il passe la frontière avec Machado, et parvient jusqu’à Bierville où il s’arrête, près de Boissy-la-Rivière, dans l’Essonne. C’est dans ce domaine qu’il commence ses Elégies de Bierville. Cinq, d’abord. D’autres suivront, en Irlande ou à l’Isle-Adam, à Bordeaux, ou à Montpellier. Dans l’exil, en à peine trois ans – de 39 à 41 –, il écrit douze élégies.
Bien sûr, le cadre n’est pas le même que celui de Rilke, à Duino. Pas de promontoire sur la mer, de regard vers l’Océan ou vers les sommets nuageux. Mais le parc d’une propriété, qui d’ailleurs apparaît peu. Juste quelques notes fugitives sur l’allée d’un parc, un chemin, des ramilles, de vivantes eaux, la tendresse des arbres de France. Et pas plus d’allusions non plus à ce qui se passe en Espagne au même moment, ou en France. Aucun écho de la fuite forcée, sur les routes, dans la frayeur. À peine une plainte sur l’exil, ou la peine, ou la détresse.
Mais, par l’effort de la mémoire, hors du lieu, Bierville, où il est – un temps – contraint de s’arrêter, Riba se projette vers la Grèce, reconstruit l’univers solaire qu’il a fréquenté dans les livres. Sounion, Salamine, Delphes, l’Attique. Comme transporté par la pensée, s’échappant de sa vie d’alors pour atteindre à plus haute vie. Alors, alors seulement, Riba peut parler d’une voix sans faiblesse, échapper à ce qui l’écrase. Alors, alors, il peut crier, tutoyer les Anges et les Dieux, se mesurer avec l’Antique, l’essentiel, l’universel.
L’être, l’histoire, la vie humaine, l’absolue pureté, la mort, le souvenir, le mystère des mots, l’exil, sont emportés dans une langue océane, se déroulant, vague après vague, nuit après nuit, à l’assaut d’un plus sûr refuge. Et tout, dans cette langue, émerveille. L’enchaînement ininterrompu de la pensée se fracassant sur l’hexamètre dactylique, ses silences. La volonté – dans cet élan – de ne pas sombrer, de ne pas s’arrêter au distique élégiaque, de ne pas y même reprendre souffle, mais de briser ou de chevaucher la métrique, pour parler, pour parler encore.
Et pour crier, d’une voix immense, ce qui peut sauver de l’exil, de la peine, de la douleur. Ce qui, seul, nous tient et nous aide : la parole, la poésie. La poésie, toujours présente quand l’Histoire nous brise en deux, nous défait, déroute et nous jette sur les routes du désespoir, ou tente de nous bâillonner. La poésie, comme seul recours, feu fragile, ou – là – incendie de forêts, orage, ou ivresse, pour surnager dans le naufrage d’une vie, quand la vie s’écroule. Ou pour tenter de voir plus haut, plus avant, plus loin, plus immense, au-delà de nos contingences ou de nos étroites pensées. Dans l’audace d’un cri en vol, ou d’un oiseau, ou d’un nuage. Dans l’Ouvert, aurait dit Rilke, de la « grande réalité ».
Ainsi, dans ses Elégies, Rilke ouvre-t-il un rempart sur la mémoire et sur la nuit, et Riba sur le feu du ciel. Sur la lumière.
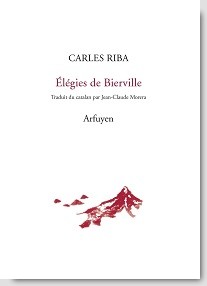
1. Rilke : Les Elégies de Duino, traduction et postface de Philippe Jaccottet, La Dogana, 2008, p. 9.





