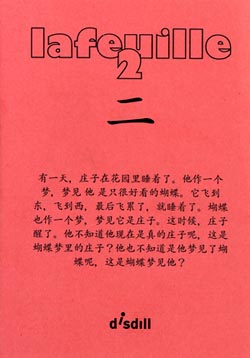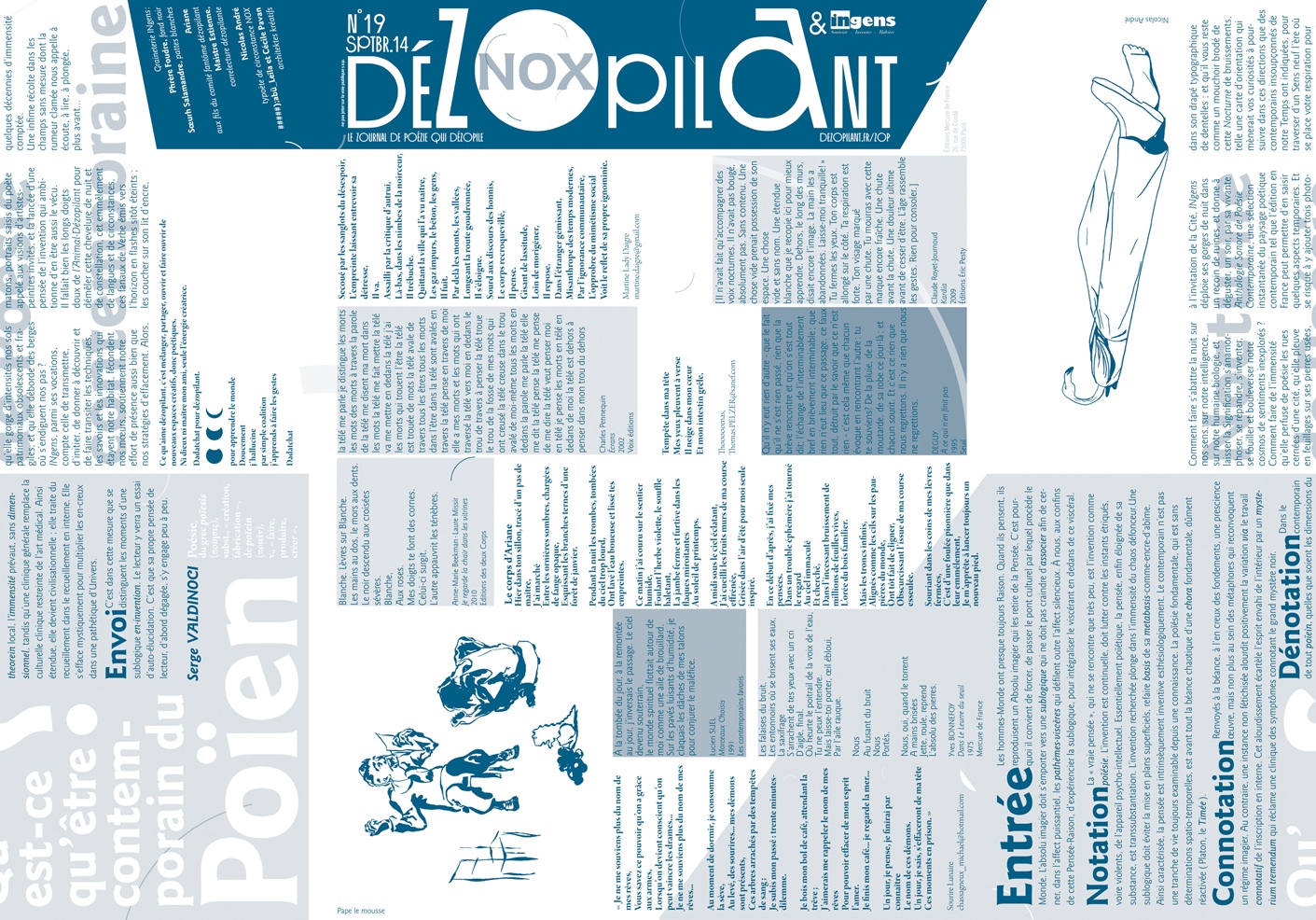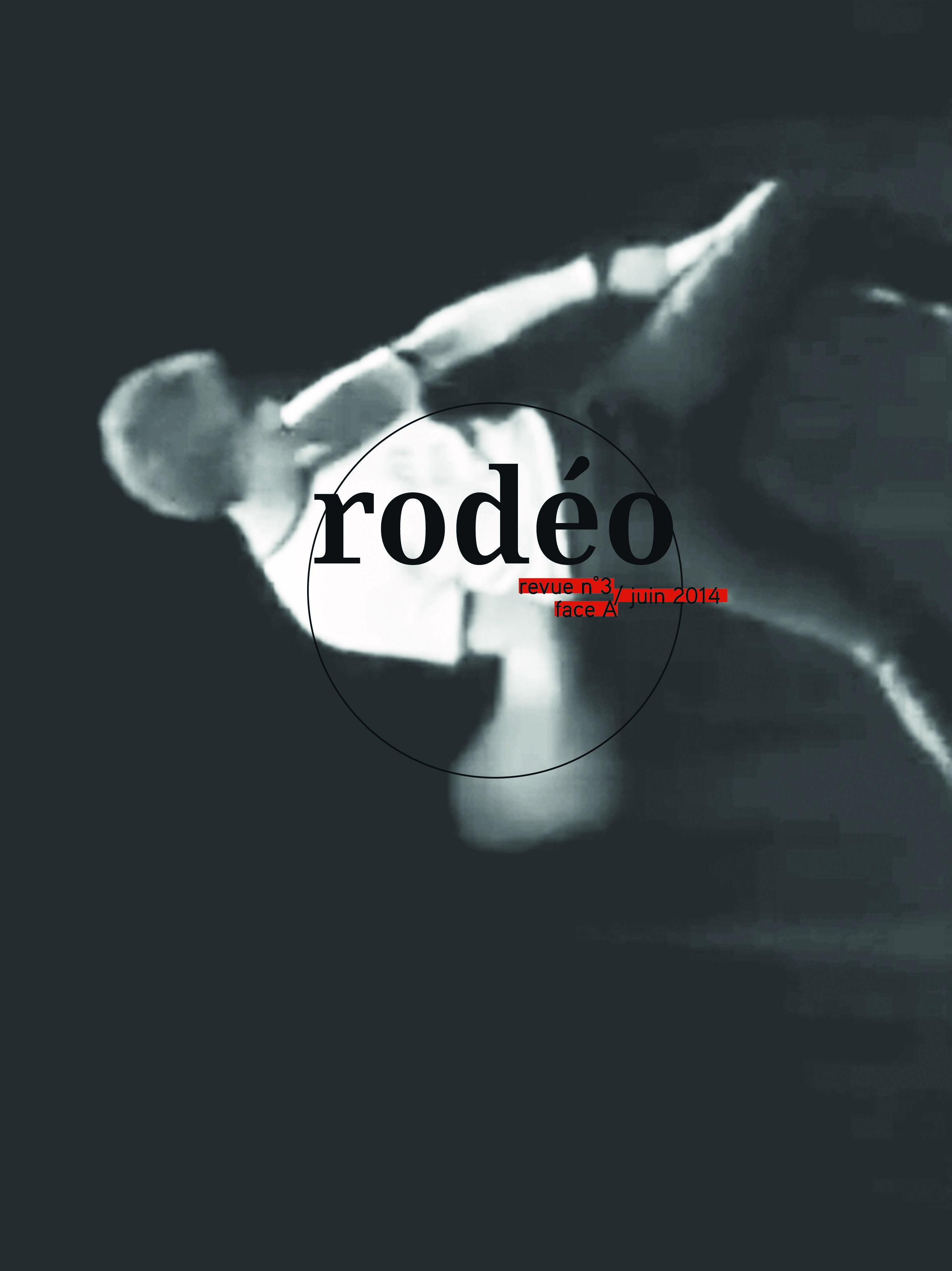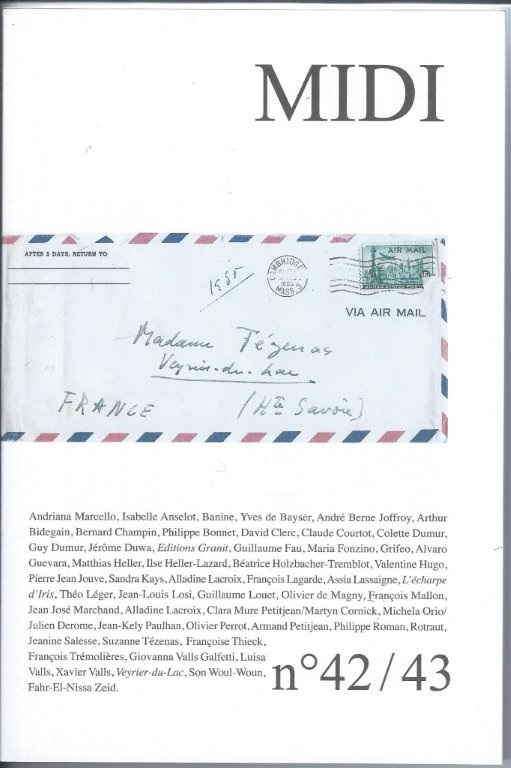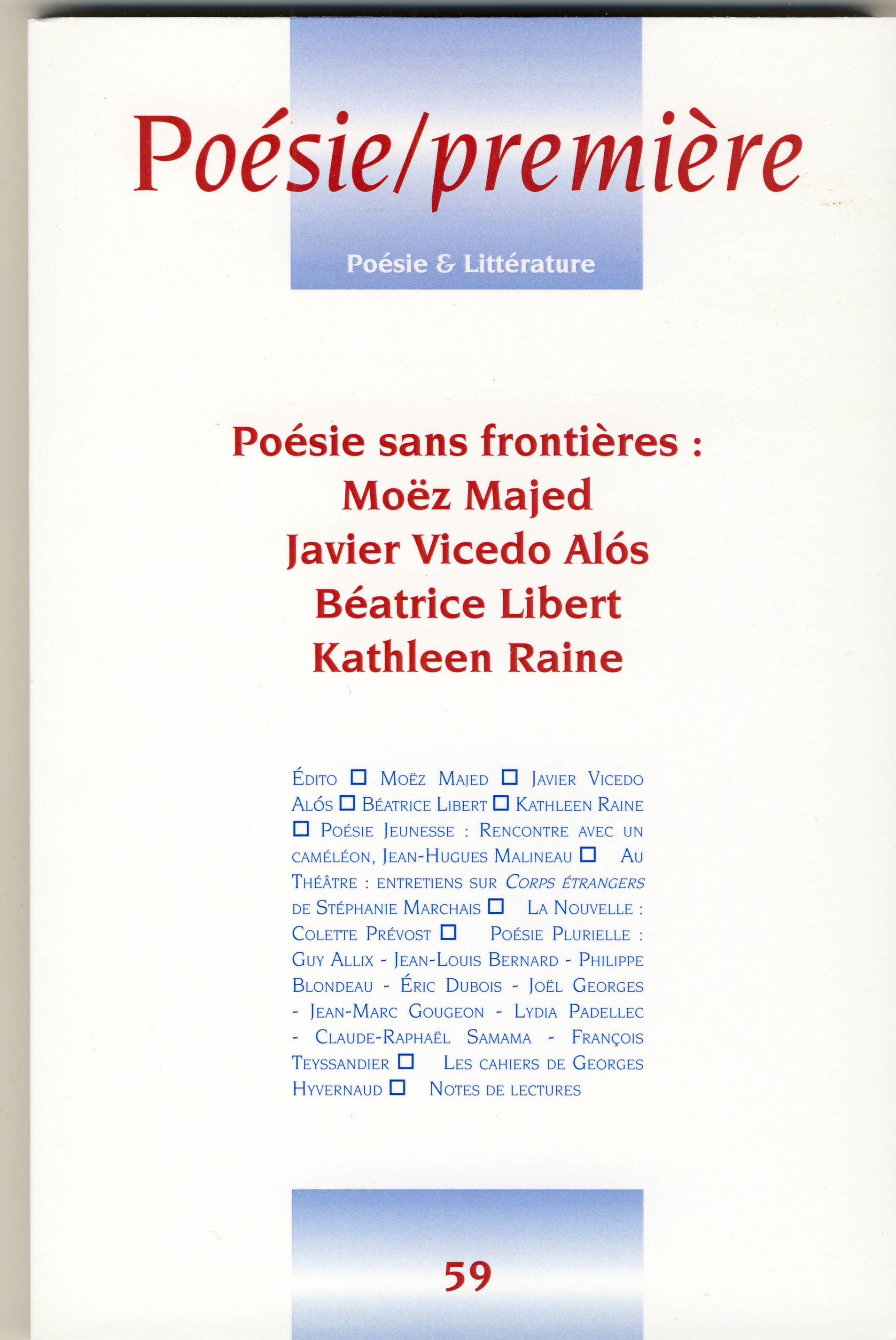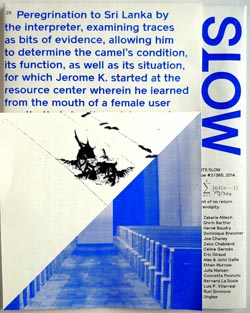par Yves Boudier
Exemple
Pour tout lecteur préoccupé par la réflexion actuelle sur le « commun », ce numéro constitue, une référence incontournable. En effet, sous différentes déclinaisons et avec un sens aigu de la réflexivité, en questionnant l’apport de mouvements tels Occupy récemment outre atlantique, celui des ZAD, ou l’exemple donné ces dernières années par les luttes arabes, la revue offre une qualité interrogative et une audace de pensée qui réjouissent dans notre contexte culturel et politique plutôt morose. Comment occuper un espace, lotir par la pensée et les actes un lieu, comment inventer des voies / voix permettant « de rendre intelligible la vie de la cité (…) et de renouer avec l’affirmation que l’esthétique est toujours politique » (Sophie Wahnich) ? Comment penser les intitulés avec lesquels la culture, la littérature se définissent et se dispersent, poésie et politique instruisant ce « pari conjonctif » où la pratique du poème « diagonalise et subtilise la langue de la politique » (Benoît Casas) ? Les réponses à ce réseau de questions prennent forme de poème (Nanni Balestrini, vingt-trois quatrains incisifs sur « les années de plomb et les années de merde »), ou celle d’un entretien avec Danielle Rancière et Jacques Rancière au terme duquel, lorsque l’on sait que « la littérature déclare et rend manifeste cet écart entre le savoir et l’action », un nécessaire réalisme des pratiques semble indispensable car « il faut tenir à la fois l’idée que la pensée produit des déplacements qui ont un poids et en même temps qu’elle ne remplacera jamais l’action politique proprement dite ». Exemple assume l’assemblage quelque peu mais intentionnellement hétéroclite des paroles et des propos tenus dans ces quelque cent dix pages, désirant « qu’il nourrisse les certitudes les plus tranchées (…) qui permettent de tisser une alliance » : terme engageant s’il en est, thème-clef de ce numéro incandescent et utile.
La feuille
Offerte par les Éditions disdill, cette feuille n° 2 se déplie en trois temps pour donner à lire deux pleines pages, l’une consacrée à des extraits de La route de cinq pieds, un poème de Michèle Métail qui interroge par son choix formel la tension entre « culture lettrée et Chine contemporaine ». Sinologue émérite, elle tient ici une forme de journal du quotidien consigné en une série très rigoureuse de vers de cinq pieds distribués en plusieurs milliers de micro séquences numérotées. D’une lisibilité parfaite, toutefois. L’autre page, revers ou avers au choix, est occupée par Jean-René Lassalle. Il transpose sous nos yeux les tons de la langue chinoise dans un sino-français lui aussi monosyllabique. Quatre modes de lecture, un pli selon pli renouvelé : de l’idéogramme chinois à son écriture alphabétique, puis du mot traduit à l’écriture du poème Gare jaune, Huáng zhàn.
Dézopilant
Voici une feuille de poésie qui a le privilège de colporter des textes, de jouer avec les cadres de lecture, entre nos mains par on ne sait quelle magie, toute de couleur bleu revêtue pour cette 19e livraison, pliable et dépliable, en deux, en quatre, en huit ou selon l’accroche textuelle d’une lettrine, la séduction graphique d’un texte, d’une signature qui donne un nom ami, une référence ou son contraire, un poème qui pousse vers un autre, cet autre toujours à l’orée d’un ultime repli qui n’est jamais le dernier possible. Inattendue et paradoxale, soutenue par les éditions du Mercure de France, elle accueille en un vrac joyeux Butor, Deguy, Royet-Journoud, Messagier, Suel, Piskurski, Bonnefoy, Pennequin, Roubaud, Fourcade, Samarski… et tente une percée : qu’est-ce qu’être contemporain du poïen ? Autant de traces, de réponses, si on les prend pour telles, d’interrogations entre joie et provocation. Lisez, songez, et… c’est (re)plié.
série z
Plaisir de recevoir un courrier, format enveloppe classique, tel qu’il se fait de plus en rare en ce temps dématérialisé. Élégamment recueillis sur un beau bristol, quatre leporellos de quatre plis recto-verso, quatre auteurs, quatre propositions unies par leurs subtiles différences formelles et une émotion partagée. Sans une thématique unique, la co-présence de voix singulières dans un espace intime de lecture les rapproche et étonnamment laisse paraître comment des différences d’écriture instruisent en creux un commun d’émotion. Arno Bertina, Anne Kawala, Stéphane Bouquet et Fabienne Raphoz voisinent et entrent ainsi, à leur corps (écrit) défendant, en conversation. Prose, note, croquis, poème suscitent une attention d’autant plus vive et heureuse que le format proposé appelle à une simple et belle concentration.
Rodéo
La revue a « tout simplement » posé la question suivante à 80 personnes : « Qu’appelleriez-vous danser ? » Elle a reçu 41 réponses. Une moitié plus une, et l’on peut tenter de chercher cette page qui fait bascule, qui fait danser l’ensemble. Chacun la trouvera à son pas, à son rythme. De la réponse philosophique teintée de spinozisme, « danser, c’est être en mouvement, reconfigurer ce qui nous entoure, s’en trouver soi-même modifié, c’est l’ouverture des possibles, l’allégresse par le chatouillement, l’acquisition de nouvelles aptitudes » (Julie Henry), en passant par le conditionnel interrogatif d’une retrouvaille possible dans la danse d’un je, d’un tu, d’un nous choral, disséminés dans un espace où « ils se retrouvent, se cherchent, se perdent et se dispersent » (Jean-Christophe Bailly), puis par les réponses graphiques d’artistes danseurs, de comédiens, de chanteurs, par celles des poètes, « C’est fatigant / cette organisation érectile des choses de la vie » (Caroline Tuut), par celles des performeurs « Capelle riez vous dansez ! / Chapelle riez ! Vous dansez / cape ailée vous danser cap hellée, maquillées ! », vous vous arrêterez peut-être sur cette plage de silence et de mouvements tenus : « J’appelle danser ce qui manque » (Frédéric Pouillaude). Vaste enquête, en contretemps heureux de laquelle une série de photographies particulièrement bien reproduites, Empty stages, de Tim Etchells et Hugo Glendinning offrent en présence des espaces scéniques en attente, pourquoi pas, de danseurs.
Riveneuve Continents / Exils et migrations ibériques au XXe siècle
Deux revues s’associent en ce numéro, l’une portant les travaux du Centre d’Études et de Recherches sur les Migrations Ibériques (CÉRMI) et du Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines (CRIIA) de l’Université Paris-Ouest Nanterre, l’autre témoignant des traces artistiques et culturelles laissées en France par l’exil républicain espagnol. Au-delà des rappels historiques de sinistre mémoire, de la définition même du terme « exilé » en se référant à des artistes, Geneviève Dreyfus-Armand, Dolores Fernández Martínez et Juan Manuel Bonet présentent, à travers un ensemble de douze contributions, études et entretiens, les multiples aspects de cet « art en exil ». Peintres, sculpteurs, dessinateurs de presse et de BD, musiciens, scénographes, photographes, cinéastes, architectes et dramaturges se partagent ces quelque trois cents pages au cœur desquelles figurent deux cahiers documentaires contenant photographies d’auteurs, reproductions de tableaux, de sculptures et de dessins. Exilés et réfugiés politiques, si certains nous sont connus, tels Picasso, Pau Casals, Carlos Pradal ou Baltasar Lobo, ceux dont nous découvrons l’ampleur et la qualité du travail, moins célèbres certes, méritent de prendre toute la place qui leur revient dans nos cultures partagées. Souffrances de l’exil, des camps de concentration, des errances et des solidarités sur lesquelles il fallut parier un avenir incertain, nous lisons là, au plus précis des exemples et des références donnés, combien l’attachement le plus profond au geste artistique, quel qu’il soit, donne force et vigueur à ces artistes en conversation avec la douleur, quand ce n’était pas avec la mort rampante, pour s’inventer un nouvel avenir. « Elle s’est trompée, la colombe, / Elle se trompait. / Allant au nord, alla au sud. / Elle crut que le blé était de l’eau. (…) Elle, sur la rive s’endormit. / Toi, sur le haut d’une branche. » (Rafael Alberti).
La Seiche
Six numéros publiés, et la revue se pose des questions sur la cohérence du parcours accompli, affirmant sa volonté de bouger les cadres, son « furieux besoin de décloisonner ». Convaincue que la modernité ne gît plus dans la destruction ou dans l’ascétisme de l’art conceptuel, elle choisit la voie de l’adhésion critique. Rassembler des écritures qui ne se rencontrent habituellement pas, rapprocher des continents esthétiques en ruptures, voilà sa stratégie et son principe d’aujourd’hui, et l’on s’en réjouit à la lecture de ce numéro d’automne. Une parole singulière traverse tous les textes et poèmes, qu’elle soit je ou tu, multiple ou solitaire, solipsiste ou partagée. Ainsi voisinent dans l’inattendu de ces rencontres, par exemple, Victor Blanc et des collages de Julien Blaine, Charles Pennequin et les poèmes ou les photographies de Franck Delorieux, Édith Azam et Lionel Jung-Allégret, l’écriture manuscrite d’Amina Damerdji et Marius Loris, en presque connivence.
Vacarme
Au centre de ce numéro, qui pose dans un ensemble nommé Indéchiffrables, une question de poids : « Que devient la politique lorsque les individus eux-mêmes deviennent indéchiffrables et se soustraient aux appareils de contrôle qui structurent leurs vies ? », on lira, en marge et en lien avec cette thématique, la reprise de la communication que fit Jean-Christophe Bailly au Banquet du Livre et des Générations de Lagrasse en août 2014, « Nous », ne nous entoure pas, un texte d’importance et au cœur des questions qui nous traversent depuis les événements de janvier dernier. Plus que prémonitoires, ces lignes soulignent le fait que la réflexion sur le thème du « commun » reste au plus vif de notre pensée et de nos actes, en particulier quand le politique vient les interroger et les soumettre à sa violence. Dépassant en toute analyse et lucidité la définition que Benveniste [1966] donna du nous, « globalité indistincte d’autres personnes » en démontrant que ce pluriel qui ne pluralise pas un je ne renvoie pas à une multiplication d’objets identiques, Jean Christophe Bailly avance le concept de nostrations pour tenter de définir ces éphémères formations que ce pronom incarne sous les formes variées d’adjonctions telles « nous deux », « nous autres », « nous tous », « nous tous ici », insistant sur la dimension dynamique qu’il convient d’ajouter à ces insularités destinales ou singulières des sujets que nous sommes dans l’Histoire. Pour lutter contre un principe de fermeture et d’assignation propre à toutes les religions, Jean-Christophe Bailly réaffirme ce qu’il nomme alors « le temps de la sortie », ce saut hors du nous que peut faire le je, doué de conscience critique, à tout moment. L’espace de ce déploiement constituerait alors un nous extensible et ouvert, riche de toutes ces nostrations à la recherche d’un espace politique ouvert, non encore construit. L’ombre de Novalis éclaire ces pages lucides.
Puis, une autre saisie dans ce numéro de grande densité : wsc-bruzignol Bvbilotékére, un poème d’Oskar Pastior, extrait de Der krimgotische Fächer, publié en 1978, jeu de langues concaténées dans des mots-valises, propulsées dans un espace d’écriture hors de tous cadres sémantiques. Une manière elle aussi, d’échapper à la norme, à la surveillance généralisée ?
Midi
Émotion rare de lire les lettres [1957-60], les excuses plutôt, que Pierre (Charles) Jean Jouve adressa à son amie Suzanne Tézenas [1898-1991], personnalité du monde de la culture qui tint à partir des années 30 et jusque dans les années 80 l’un des derniers Salons littéraires parisiens. Excuses de ne pouvoir se rendre à différentes soirées concert, de ne pouvoir écouter le jeune Boulez, ou de participer à ces moments offerts par le Domaine musical, fondé par son attentive correspondante. Fatigues, maladies, traductions, souci de l’écriture, séjours à Sils-Maria dans la froide Engadine, passages de frontières… comment donner corps au désir de rejoindre l’appartement parisien de la rue Octave Feuillet ou plus intimement la villa de Veyrier du Lac en Haute-Savoie, où se retrouvaient, entre autres amis musiciens, peintres et poètes de Suzanne Tézenas, Eugène Ionesco, Roger Caillois, Jean Paulhan, Georges Schehadé, Otavio Paz, André et Bona Pieyre de Mandiargues, ou Guy Dumur dont la revue offre ici quelques cartes postales new-yorkaises (1955) qui témoignent quant à elles de sa distance avec les Américains : « On vit entouré d’esprits enfantins (…) Tout ce que l’on fait ici est parfaitement inutile (…) Beaucoup de conférences, très abrutissantes (…) Pays stupide ! » Seule la ville de New York trouva grâce à ses yeux. Pour compléter ce numéro dédié à la mémoire de Suzanne Trézenas, poètes et artistes sont rassemblés en un cahier de presque cent pages par Françoise Thieck, et ce dans une heureuse diversité allant d’Yves de Bayser à Jeanine Salesse ou Theo Léger, d’Assia Lassaigne à Jérôme Duwa ou Sandra Kays.
Gruppen
Inscrite fortement dans le paysage revuiste depuis cinq ans, la revue « dénonce l’indigence de certaines aventures monomaniaques et soutient la qualité d’un travail critique en rétablissant les liens indéfectibles et nécessaires qui unissent les différents domaines de création. » Dont acte, et le parcours effectué à ce jour en témoigne vigoureusement. Musiciens, musicologues, philosophes, cinéastes, plasticiens partagent leurs réflexions, mais elles-mêmes questionnées, voire déroutées ou contredites par les poètes. Ainsi, dans ce numéro, Serge Pey : « La vraie vérité / est celle qui trompe la vérité / à laquelle tout le monde croit », Charles Pennequin : « J’aurais pas dû parler de ça ici. Ça fait toujours mauvais effet », et Laurent Jarfer : « Il y a toujours trop de langue sous la phrase pour qu’elle ne tombe pas comme au milieu d’elle-même », tous trois réaffirment l’acharnement du poétique à ne jamais se trouver là où la langue l’attend, où les formes se répètent et s’oublient. Peut-être sont-ils ainsi plus proches du geste du photographe qui cadre, c’est-à-dire scarifie dans une matière dont l’image obtenue donne à comprendre l’indéterminé d’où elle provient, l’invisible d’un excès de présence du réel ? Esther Vonplon confirme en l’occurrence cette hypothèse avec une série photographiée en Pologne durant l’été 2009 : Und in der Nähe die See. À la fois discrète et sensiblement banale – et ce n’est de ma part aucunement un reproche – voici en quatre pages la saisie d’espaces d’une grande neutralité, mais qui renvoient pour autant à l’expérience la plus intime de notre regard sur la nature et les choses du monde. Et ne pas refermer ce volume sans lire le texte Capitalism + Dope = Genocide, écrit par Michael « Cetewayo » Tabor [1946-2010] durant ses années de détention en tant que Political Prisoner, NY 21, car membre du Black Panther Party. Les récents événements de Baltimore nous ramènent à cette histoire terrible dont la société américaine n’est toujours pas sortie, ce que l’on comprend mieux encore lorsque l’on apprend, sous cette plume de fer et de sang, que la preuve est patente « que la toxicomanie est le symptôme monstrueux d’une tumeur maligne qui ravage le tissu social de ce système capitaliste. »
Poésie / première
Concentrer son attention et sa lecture sur le dossier de ce numéro, Poésie sans frontières, avec un poète tunisien francophone, Moëz Majed, un espagnol, Javier Vicedo Alós, et deux femmes, l’une belge de Wallonie, Béatrice Libert et l’anglaise Kathleen Raine [1908-2003]. De l’insurrection du poème, « Et vivre toute une vie dans un poème inachevé » (M. Majed), à la tentation du silence, « Nous noierons la voix dans des jours blancs / et nous n’aurons rien dit » (J.V. Alós), la conviction poétique de B. Libert : « L’inaccompli des choses / Et nous cousons leur pli » s’inscrit dans le sillage d’extraits de Living with Mystery, le dernier recueil publié de K. Raine en 1992 : « As unshet tears / That sunlit wall, that corner of a stair. » Poèmes et poètes de tradition classique, dont l’esthétique et les choix d’écritures sont marqués par un usage génitif de thématiques « poétiques » que l’on retrouve à la fois dans les pages consacrées à Jean-Hugues Malineau, (poète pédagogue à qui l’on doit un classique, L’enfant La poésie [1973], où apparut une approche pédagogique novatrice de l’enseignement de la poésie) et dans le dossier Poésie / plurielle, avec Philippe Blondeau ou Lydia Padellec, par exemple.
Mots Slow
Essentiellement rédigée en anglais, seul le texte d’Hervé Baudry, peut-être parce qu’il fait référence première à Mallarmé, se donne dans notre langue. But, never mind, « You, readers, itinerant bookshops, you are the regulators of our abscissa : ordinate the panes of a luminous rosette on your face, by reading Mots Slow trough the sun. (…) It pleases me that it crosses cities and towns, travels from one hand to the next, from house to house, from bookshop to library and will always necessarily be forgotten somewhere ». Ainsi Jérôme Karsenti présente-t-il cette livraison, Point of no return – Serendipity, sous la forme unique étonnante et superbe d’un seize pages qui se déplie telle une affiche recto verso, face textuelle et face graphique. Est-ce une revue, au sens classique, ou bien le don d’un document sibyllin pour troubler notre adhérence aux mondes que l’on sillonne entre les langues ? Un moment de grand plaisir pour un œil lecteur et plastique, in any case.
Le Chant du Monstre
Revue de Création littéraire & Curiosités graphiques, « le Monstre hybride hume l’air du temps, s’ouvre à la création mouvante. Le chant alterne entre expérimentation, coup d’éclat et hésitation ». La métaphore du « chaudron de sorcière » s’impose d’entrée pour caractériser les exemples proposés de différentes démarches créatives, « repoussantes et toxiques pour les uns, bienfaisantes pour les autres », en tout cas consolantes, pour reprendre le vocabulaire de Michelet. Organisée en six parties (Affinités électives – Alchimie – Seul contre tous – Ex-qui ? – Cabinet de curiosités – Parce que !), nous lisons dans ces pages le double témoignage d’éditeurs (Cambourakis et Laure Limongi) qui font leurs ces propos tenus naguère par André Schiffrin (L’Édition sans éditeurs, La Fabrique, 1999) : « De plus en plus de livres sont publiés pour leur potentiel commercial supposé et de moins en moins représentent cette part intellectuelle et culturelle que les éditeurs se sentaient l’obligation d’inclure dans leur production » et qui affirment derechef que la « littérature visible » doit être « celle qui avance, agite, se réfléchit et fait réfléchir, celle qui tourmente, et celle qui n’autorise pas la fainéantise. Celle qui résiste. » La revue s’impose à elle-même cette loi d’exigence en rééditant des textes mythiques devenus (presque) introuvables (Neige, d’Anna Kavan, 1901-1968, Jérôme, de Jean-Pierre Martinet, 1944-1993), en redonnant la trace vivante d’auteurs plus récemment disparus (Anne-Marie Albiach, Christophe Tarkos, évoqués sensiblement par Laure Limongi) et en publiant parallèlement des œuvres de création contemporaine, par exemple le travail « en collision » de l’artiste Laurie Bellanca et de l’écrivain Orion Scohy, ou l’écriture singulière d’Andréas Becker à travers ces Fleurs de fer, au terme desquelles, après avoir fait commerce de l’ensemble des parties de son corps, Anne-Sophie de Sainte-Pieuse, une Sans-Papière, en vient à vendre ses « a » (objet petit a ?) « Je s-is, l-issez-moi tr-nquille -vec ç- ; -ucne import-nce l’-ded-ns, -ucune ».
La partie purement graphique est elle aussi d’importance avec l’artiste coréenne Keun Young Park et la dessinatrice japonaise Fuyaka Etsuko. Quant au choix du format de la revue, 29x15cm, il est en l’occurrence parfait pour donner la meilleure place aux Indociles, (p. 76) : « Plutôt la rame qui fend l’eau que la tête de gondole. Le subreptice que le bénéfice. La nécessité que la publicité. Indociles, au pluriel, au multiple. »
Le Tigre
S’il est déplacé d’employer le terme de « fidélité » à propos du parcours entrepris depuis une dizaine d’années par ce magazine plutôt que revue, on note néanmoins, avec cette livraison, le même esprit d’originalité, de critique implicite des codes de visibilité contemporains, le même goût du détournement, voire de la provocation visuelle et graphique. Est-ce parce que Le Tigre ne tient « compte ni de la notoriété, ni de la formation, ni d’éventuelles recommandations » des contributeurs, n’opérant ses choix que selon « la seule pertinence, dans le cadre tigresque, de l’image ou du texte » proposés, qu’il entretient cette pertinente et belle tonicité ? Trente-sept participants, (aux appellations diversifiées telles Space Project (Vincent Fournier) et Lucha libre, « Por mi pueblo hablará el deporte », (Aurore Valade) pour le Portefolio photographique, Les choses ou Têtes galerie, L’Encyclopédie approximative, L’Horroroscope ou Conjugaison ordinaire, parmi d’autres approches, pour le Magasin), avec au cœur du Tigre, deux « Grands Papiers » : un entretien avec Gilles, brocanteur, où l’on découvre la sagesse d’une grand-mère : « N’est pas beau qui plaît », les conséquences de la maladie de « Diogène » et les arcanes complexes des successions qui appellent au débarras. Puis un reportage à Hénin-Beaumont (Portrait de petite ville – un jour de braderie – avec visite de Marine Le Pen) dont l’épilogue dit, horresco referens, l’essentiel : « Ce jour-là, un homme vendait, parmi un peu de tout, des fossiles et des morceaux de charbon, issus des dernières gaillettes de houille remontées dans le bassin houiller avant la fermeture définitive de la fosse en décembre 90. »
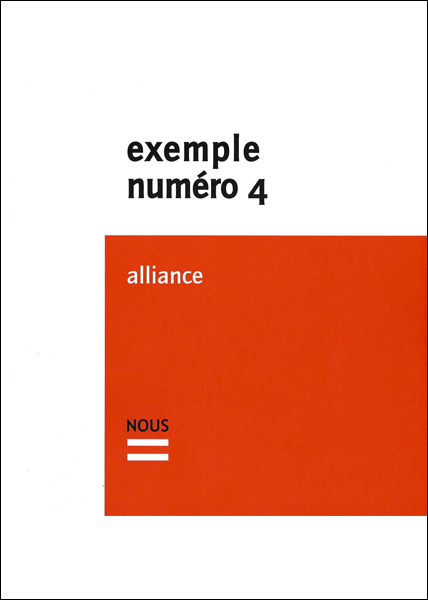
N° 2
Disdill
2 p., offert