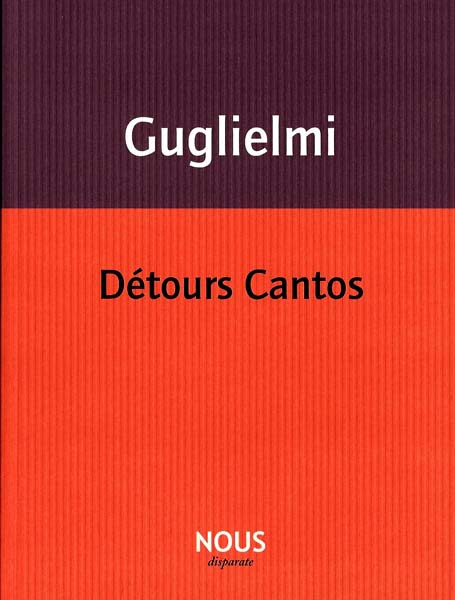par Frédéric Valabrègue
Détours Cantos est le dernier livre publié par Guglielmi de son vivant, un des plus beaux. Au cours de son œuvre, il est retourné de façon cyclique à une lecture d’Ezra Pound déclenchant dans sa propre écriture emportement et furie. Ce n’est d’ailleurs plus une lecture mais la mémoire disloquée de ce qu’il a lu, permanence d’une voix créant un appel d’air où s’engouffre le présent. Aucune citation, référence, allusion ou commentaire qui ne soit pas caillots roulés par une crue, débordement. « Poundérable » est-il écrit dans Fin de vers (1986) et c’est sans « poundération » que les impressions contradictoires se percutent à propos du barde américain. Guglielmi entre dans les répons et échos de son vortex, où les langues s’accompagnent et se superposent, à la façon d’un sanglier ligure, en fouissant. Face au maestro, il tire son irrévérence du sexuel, du trivial, et adopte une attitude de mécréant devant cette épopée de l’héritage perdu. Ce qui est en germe chez Pound continuateur de Walt Whitman, il le pousse à l’extrême dans son propre espace prolétarien, matérialiste et d’une sensualité abrupte.
Détours Cantos ne ressortit pas à l’opération initiée par Lautréamont, ça n’est pas du détournement, sinon mineur, plutôt un bout de route dans les impasses et chemins de traverse de l’œuvre poundienne, lyrique, majuscule et séculaire, brèves appropriations au pied de la lettre et en bas de l’échelle. Détours, comme au détour des rues, ou comme on emprunte un itinéraire buissonnier. Guglielmi s’empare de ce qui fait de Pound une canaille plutôt qu’un aède. Il n’y a jamais de tentation encyclopédique chez l’italo-marseillais d’Ivry ni de déploiement d’un savoir. Son Pound n’est pas rabattu au sol mais ne porte pas la cape et ne présente pas le beau profil d’un effet d’érudition. Il est plutôt celui des conversations de cow-boys, de l’invention d’un jive, d’un cockney, et de l’usage du patois, frioulan ou romagnole à la façon d’un pasolinien ragazzo di vita, face au mandarin.
Donc nul hommage. Se servir de Pound, au-delà de l’admiration réelle, comme d’une pierre d’achoppement ou d’une planche d’appel. Non pas « se servir de » comme un voleur, quoique, mais ouvrir la cage de fer du « Pauvre dément »... Il faudrait se lancer dans une étude très précise de l’œuvre de Pound et de celle de Guglielmi pour sentir à quelle place ils mettent la notion d’intertextualité et si cette notion de nos vieilles années soixante-dix est convaincante dans leur deux cas. Il me semble que, pour les deux, la voix des poètes crée la profondeur du paysage et même sa matérialité, que les boues de l’Arno tourbillonnent avec les cercles de Dante, et qu’il y a plus de bleu dans l’adjectif d’Hölderlin que dans la couleur de Fra Angelico. L’intertextualité, c’est la fraternité de la communauté inavouable, jamais la culture, ce cadavre. Devant la tombe de San Michele, me proposant un voyage sentimental, j’entendrai toujours ce souffle énorme passer entre les barreaux.
Une des dernières fois où j’ai rencontré Joseph Guglielmi, il m’a dit cette phrase que je remue sans la comprendre : « Ce qui compte, c’est l’embouchure ». Je ne peux plus regarder un fleuve entrant dans la mer sans y penser, ni le mélange des eaux entre le canal et la lagune.
« Prenant Les Cantos pour mémoire
sans aucun souci du futur
Pauvre dément mais droit
dans ton âge de merde
et de fer
à Rapallo et Liguria
quand la chaleur s’est retirée
de ta peau
que tu psalmodies
la douceur
du blasphème »