par Sébastien Hoët
Les deux recueils d’Emmanuel Moses se lisent en contrepoint l’un de l’autre et donnent alors le sentiment d’un unique recueil qui s’accomplit : d’un côté, avec Ivresse, des vers rimés mais d’une vraie liberté, des poèmes qui filent assez rapidement, de l’autre, la Polonaise appesantit le pas, tient la note dans des proses parfois denses. Mais une telle spécification des genres poétiques est trompeuse, et le lecteur pourrait, agacé de ne s’y point retrouver malgré la simplicité des apparences, adresser le reproche suivant à l’écrivain : « (…) je suis admiratif de ton talent même si je pense que tu devrais finir par te décider entre la poésie et la fiction » (Polonaise, p. 35). Le reproche formulé avec un vrai sens de l’autodérision de la part de l’auteur à un écrivain imaginaire se poursuit et s’élabore de façon plus essentielle, et même didactique, par l’explication selon laquelle les deux genres sont « incompatibles » et même « s’anéantissent au contact l’un de l’autre ». De fait, les livres de Moses jouent avec cette indécidabilité des genres à l’intérieur des genres eux-mêmes1 : la prose est plutôt poème et le vers tend au récit, ce qui déséquilibre et trouble la lecture dans l’instant où, pourtant, une certaine lumière, une clarté, se répand. Mais cette lumière est trouble : chez Moses, on bute sur des points d’opacité absolue, comme ces objets que l’écrivain dit « fuyants », avec lesquels il peut y avoir rencontre mais jamais compréhension, témoin ce savoureux dialogue intitulé Contact (Polonaise, p. 15 sq) qui a lieu entre un pilote confronté à un OVNI, jamais nommé comme tel, et la tour de contrôle. Pilote qui finit par disparaître. Ou tel « objet rouge non-identifié » (p. 88). Dans Ivresse, c’est l’énonciateur qui fait écran ou indécide le recueil tout entier : « Mon immeuble est hautement mélancolique / Les étages sont vides et le papier s’effrite / (…) Ma voisine du second a été victime d’une attaque / Elle n’ouvrait plus sa porte, depuis que son mari était mort de la prostate » (p. 12). On dirait du Jules Romains à ses débuts mais avec ce trou, ce point d’opacité encore une fois, qui bée chez ou dans les personnages de Simenon, dans Le Bilan Maletras ou La Vérité sur Bébé Donge, et les fait tellement libres et vivants. Dans ce trouble de l’énonciation, de la séparation des genres, le sens lui-même se met à flotter et se dilue dans une forme de bêtise ou de ce que Moses appelle un « Rêve idiot » (Polonaise, p. 76). Ce n’est pas toujours l’écrivain qui écrit mais une forme humaine, une silhouette qui subit le monde naïvement, et qui, du fond de cette incapacité qu’est l’idiotie, mais en outre de cette singularité de l’idios, est inversement capable de donner la formule du monde telle qu’inaperçue par les gens trop intelligents : « Nous sommes tristes de naissance (…) Il ne s’agit pas d’un regret ardent, d’une déconvenue / D’un chagrin qui attend sa consolation / Mais d’une nouvelle réalité : celle de l’homme à l’abandon » (Ivresse, p. 14). La question est alors posée de l’idiot au poète, ou de l’idiot dans le poète : « Et la tristesse ou la détresse / Permettent-elles la note du chant ? » (p. 25) La réponse est positive, elle tient dans ces livres, à ces livres, où l’on préfère le zombie déchu au survivant arrogant, dans un monde-prison où le langage nous enferme lui aussi ; mais fragile, elle est comme une chanson, un petit air à peine discernable qui monte du dessous de l’homme et du monde.

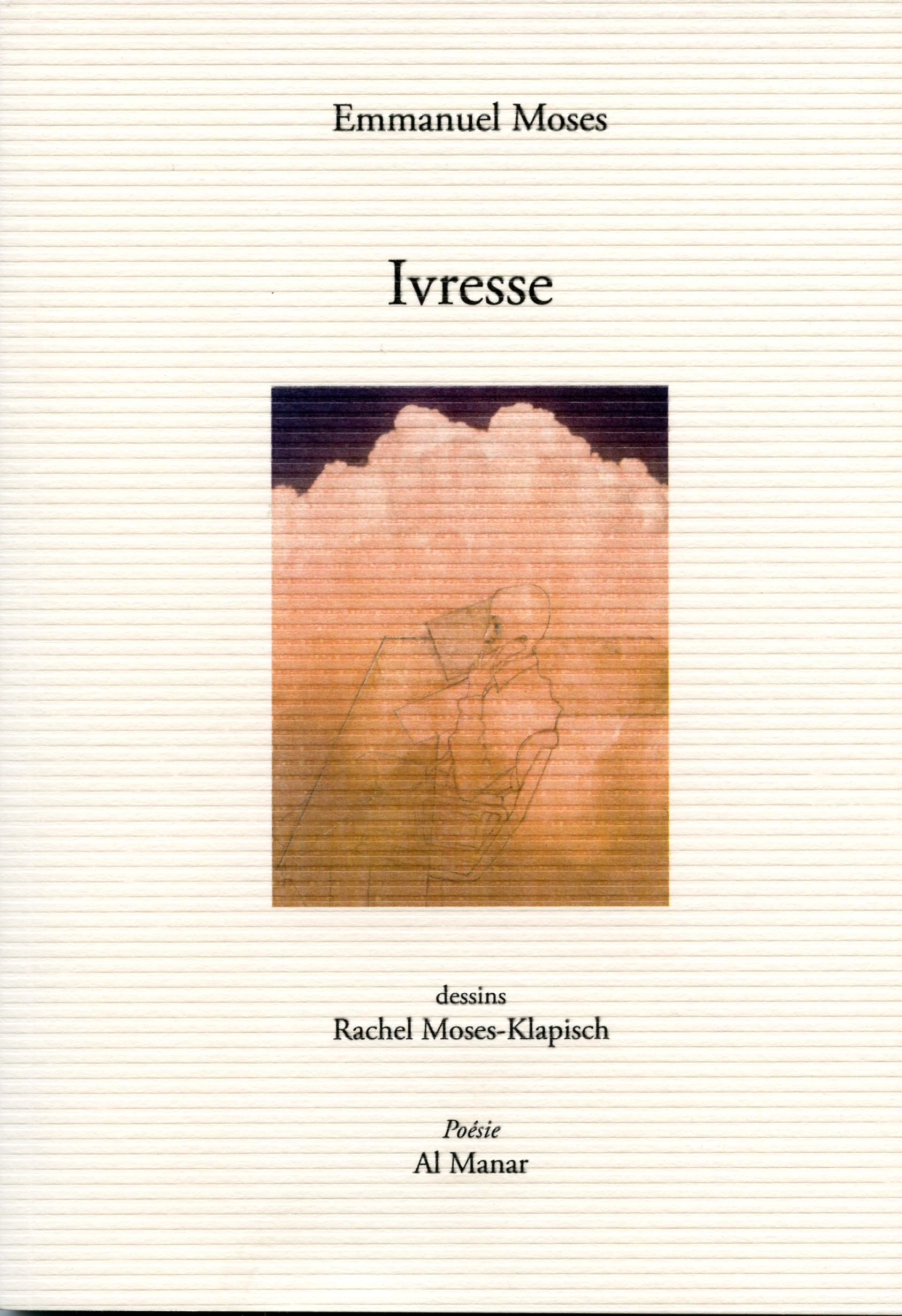
1. « Le secret du poème est bien son instabilité et sa fugacité », Polonaise, p. 31. Le poème comme la récusation de son genre.





